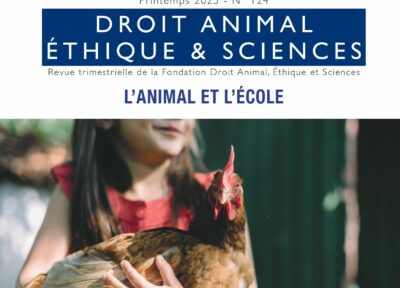Comment les programmes scolaires français abordent-ils les questions relatives aux animaux ? Cet article dresse un panorama des enseignements sur les animaux à l’école primaire, au collège et au lycée.

Les animaux occupent une place réduite dans les programmes scolaires français : ils sont étudiés essentiellement sous les prismes de l’espèce et de la biodiversité, et non selon leur individualité (sensibilité, cognition…). Quel est donc l’état des lieux, en France, de la place de l’éthique animale dans les programmes scolaires ? Ceux-ci sont fixés cycle par cycle et définissent les compétences et connaissances à acquérir. Cet article propose un panorama, tous cycles et filières confondus, de l’enseignement de l’éthique animale.
La situation dans la loi
Certains articles de lois abordent explicitement l’enseignement de l’éthique animale à l’école. La loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes indique à l’article 25 que la « sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie » fait partie du programme du service national universel. Ce même article instaure, à l’article 312-15 du code de l’éducation, entré en vigueur en décembre 2021, le « respect des animaux de compagnie » qui doit être intégré aux programmes d’enseignement moral et civique (EMC) au primaire, au collège et au lycée.
Programmes du cycle 2 (CP, CE1 et CE2)
Avant la rentrée 2024 et la réforme des programmes d’EMC qui l’a accompagnée, l’éthique animale n’était pas abordée au cycle 2, malgré les attendus en matière de respect du vivant et de lutte contre la maltraitance animale. Depuis, le programme officiel propose d’« aborder la question du respect dû aux animaux » en classe de CP, dans le cadre de l’enseignement du « respect qui est dû à l’environnement et au vivant, des espaces familiers aux espaces plus lointains, qui sont des biens communs » (section « Les règles collectives et l’autonomie »).
L’éthique animale pourrait pourtant être abordée indirectement dans le cadre de la « culture de la sensibilité » en abordant la lutte contre la maltraitance animale. L’étude des animaux apparaît davantage dans la matière « Questionner le monde », qui comporte notamment comme objectif pédagogique l’adoption d’un « comportement éthique et responsable ». C’est également dans ce cadre que les animaux sont identifiés, observés, et distingués des végétaux, par exemple en abordant les chaînes de prédation.
Lire aussi : L’éthique animale à l’école : apport de la société civile
Programmes du cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
Cette étude générale se poursuit au cycle 3 avec observations et expérimentations. Progressivement, avec la matière « Sciences et Technologies », et en particulier le thème « La Planète Terre : les êtres vivants dans leur environnement », l’animal fusionne avec le reste de la nature et la notion d’écosystèmes. Les concepts de biodiversité et de développement durable sont au cœur des programmes d’EMC. L’un des objets d’étude est, par exemple, « [l]a responsabilité de l’individu et du citoyen dans le domaine de la santé, du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable » ; l’éthique animale n’est pas explicitement abordée.
Programmes du cycle 4 (5e, 4e, 3e)
Les programmes de physique-chimie et de sciences et vie de la Terre (SVT) sont parmi les plus prometteurs du cycle 4. L’un des objectifs est notamment la préparation d’une « citoyenneté responsable » en lien avec l’environnement, ainsi que la distanciation d’une « vision anthropocentrée du monde et [des] croyances [des jeunes] ». C’est également pendant le cycle 4 que commence l’étude de la classification des espèces et l’étude de l’évolution et de la génétique. Les SVT incluent par ailleurs une réflexion autour des « conséquences de certains comportements et modes de vie », notamment autour de la disparition d’espèces animales. L’EMC est enseigné une heure par semaine et les animaux ne sont évoqués que pour illustrer la notion d’engagement citoyen en prenant « l’exemple de l’engagement en faveur de la cause animale ». L’étude de lois éthiques, morales, et sociétales fait néanmoins partie du programme et l’éthique animale pourrait y être étudiée.
Lycée
Au lycée, la sentience animale n’est pas au programme des matières scientifiques et les animaux sont toujours étudiés sous le prisme de l’espèce, bien que le développement d’un « comportement éthique et responsable » concernant la « préservation des ressources de la planète », dont la biodiversité, fasse partie des objectifs en SVT. L’enseignement scientifique de première doit également proposer des réflexions autour de la bioéthique et de la responsabilité environnementale.
En revanche, on retrouve l’éthique animale dans les humanités et sciences sociales. En langue vivante, par exemple, l’axe 7 intitulé « sauver la planète et penser les futurs possibles » interroge la « cause animale » et se centre autour de pratiques comme la chasse et la corrida. Avant la réforme de 2024, l’EMC explorait également une « réflexion nouvelle sur la cause animale » autour de l’axe « Recompositions du lien social ». Désormais, il est proposé d’aborder l’animal comme « objet de droit » dans l’objectif de sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement.
En première, la spécialité Humanités, littérature et philosophie comporte le thème « Les représentations du monde » avec la subdivision « l’Homme et l’animal », qui inclut des réflexions « philosophiques, éthiques et pratiques » sur la relation entre l’Homme et l’animal, et où « les questions de l’intelligence animale et de la communication entre les animaux sont abondamment débattues ». Par ailleurs, cette spécialité est la seule à aborder explicitement les droits des animaux dans le contexte des « questions vives d’aujourd’hui ».
En 2018, l’épreuve de français du bac pour la filière scientifique (S) et économique et sociale (ES) comportait un extrait d’un essai de Marguerite Yourcenar (Qui sait si l’âme des bêtes va en bas ?), dédié à la Déclaration des droits de l’animal. La LFDA avait d’ailleurs mis en lumière cette épreuve en organisant un concours qui récompensait les meilleures copies.
Dans les filières technologiques, c’est par exemple dans la matière de droit et économie, en première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), qu’est abordée la question de la personne juridique, qui permet de discuter du statut de l’animal. C’est également le cas de la spécialité en terminale générale avec option « Droit et grands enjeux contemporains ».
Enfin, les élèves de BTS de la session 2026 étudieront tout au long de l’année, dans le cadre de leur épreuve de Culture Générale et Expression (CGE), le thème « Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal ». Les axes et la bibliographie soumis par l’Éducation nationale abordent des questions morales, sociales et écologiques qui traversent l’ensemble du sujet animal. Cette matière, qui combine notamment des apprentissages philosophiques et scientifiques, permet ainsi une approche transversale qui se révèle idéale.
L’avis du Conseil supérieur des programmes (CSP)
Dans sa « Note sur le renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable dans les programmes de la scolarité obligatoire », parue en décembre 2019, le CSP critique l’approche traditionnelle des programmes consistant à englober animaux et environnement. Il indique que « l’étude de la biodiversité ne peut être réduite à la description de la faune et de la flore ». Le CSP affirme que « les questions liées au climat, à l’environnement et à la biodiversité […] ouvrent sur des questions éthiques, anthropologiques et existentielles : l’Homme et la nature ; l’Homme et l’animal ; le sens et les limites de la domination humaine, etc. ». Cette note soulève donc l’espoir d’une évolution positive en faveur de l’éthique animale et d’une reconnaissance de l’individualité des animaux lors de prochaines refontes des programmes scolaires.
Conclusion
L’éthique animale occupe donc une place souvent mineure dans les programmes scolaires en France. Les animaux sont intégrés aux notions générales de « biodiversité » ou de « monde vivant », tandis que la loi relative à l’enseignement de l’éthique animale ne met l’accent que sur les animaux de compagnie. La sentience animale n’est pas mentionnée dans les programmes de sciences naturelles, mais d’autres matières peuvent permettre de parler d’éthique animale. Ce sont les humanités et les sciences sociales, notamment la littérature et le droit, qui permettent une réflexion sur ce thème au lycée.
Néanmoins, les programmes scolaires présentent avant tout des propositions de « démarches et situations d’apprentissage » permettant d’aborder le socle de connaissances que les élèves doivent savoir maîtriser. Les enseignants bénéficient ainsi d’une liberté pédagogique qui leur permet de s’appuyer sur les thématiques et les ressources de leur choix pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Les plus sensibles sauront donc mobiliser le sujet animal dans leurs enseignements. Certains éditeurs de manuels permettent également de sensibiliser les élèves via des sujets et exemples concrets, et le CSP soutient l’enseignement de l’éthique animale. On peut donc dire qu’il y a un décalage entre les avancées sociétales, scientifiques, juridiques et éthiques concernant les animaux et la place qui leur est accordée dans les programmes et manuels scolaires français.
Jordane Liebeaux, doctorante en droit à l’université de Bristol & Léa Le Faucheur, responsable des projets à la LFDA