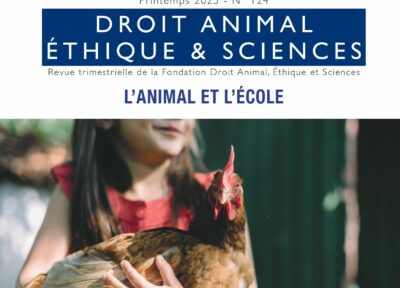Parmi les conséquences de l’augmentation de la température de la région arctique et de la fonte de la banquise, la menace sur la survie de l’ours polaire est souvent évoquée, au point d’être devenue le symbole des bouleversements de la biodiversité qui sont à craindre, sinon à prévoir.
S’il a déjà été observé des ours en mauvais état, amaigris, sous alimentés en chair de phoques habituellement chassés sur les plaques glacées et non en pleine eau, il a en revanche été noté que déjà les régimes alimentaires se sont modifiés : des ours blancs ont été filmés sur la terre ferme, en train de saisir des poissons dans un cours d’eau. Ceux-là se sont déjà adaptés pour survivre.
L’espèce parviendra-t-elle ainsi à survivre ? Le réchauffement climatique atteint tout autant la région polaire sud, dont l’énorme couverture glaciaire s’est déjà amincie, où les franges de banquise se rétrécissent, et où augmente la température des eaux des océans. Dans ces eaux, à profondeur moyenne, vivent des populations considérables de poissons et autres organismes marins, dont se nourrissent plusieurs prédateurs, en particulier dans la zone correspondant à la limite nord des eaux de l’Antarctique.
Une équipe scientifique franco-japonaise, dirigée par Charles André Boste et Cédric Cotté (1) a recherché quelles peuvent être les conséquences des variations climatiques dans l’hémisphère sud, notamment sur le comportement et la dynamique des populations du prédateur clé de l’océan Austral, le manchot royal (Aptenodytes patagonicus), de l’Atlantique Sud à l’océan Indien subtropical. Ce travail, mené sur place de 1992 à 2010, a fait l’objet d’une publication dans la revue Nature Communications du 27 octobre 2015 (2).

L’objectif était de recueillir des informations sur ce qui se passe en mer, jusqu’à quelle distance, et jusqu’à quelle profondeur les manchots plongent-ils, ce que n’avaient pas permis les observations des colonies, et l’appréciation de leur taux de reproduction. Pour cela, des manchots de l’Archipel Crozet (qui abrite la plus grande colonie d’Aptendytes de l’Océan austral) ont été équipés de capteurs, et observés durant plusieurs étés australs.
Les sorties alimentaires se font jusqu’à 300-500 km ; les plongées, répétées jusqu’à la quantité de captures nécessaire, sont de durée variable mais peuvent atteindre jusqu’à deux fois le temps du trajet. Dans les années les plus chaudes, les manchots sont allés plus loin, et ils ont plongé plus profondément, ce qui n’est pas étonnant puisque les poissons s’agglomèrent dans la zone de température fraîche qui leur convient.
Dans l’été 1997, a eu lieu un réchauffement anormal de l’océan Indien sud-ouest. La moyenne des distances de recherche de nourriture parcourues par les manchots a été alors considérablement augmentée, presque doublée par rapport aux années habituelles. De même, les profondeurs des plongées ont augmenté de plus de 30 %, la moyenne atteignant 170 m. Dans ces conditions très défavorables, le nombre des poussins a connu une baisse de 34 %, déficit qui n’a été récupéré qu’en 2002.
Cela suggère fortement, d’une part que les deux compartiments physiques et biologiques du sud-ouest de l’océan Indien ont répondu immédiatement à un accident climatique, et d’autre part que les anomalies affectent à leur tour les manchots royaux quant à leur répartition en mer, à leur comportement alimentaire, au succès de leur reproduction et, finalement, à la dynamique des populations, en raison de l’effort physique augmenté (donc la dépense énergétique), ce qui a affecté négativement et à long terme certains paramètres démographiques de l’espèce.
Or la hausse de température de 2 à 3° C observée en 1997 est celle que l’on peut prévoir dans cette région australe à l’échéance de 4 ou 5 décennies. Ce qui signifie que les populations des manchots sont menacées par le réchauffement climatique, et cela d’autant plus gravement qu’il n’existera pas de rémission de température, comme celle survenue après 1997, qui avait permis la reconstitution des populations.
Ainsi Cédric Cotté (Le Monde, 4 novembre 2015) ne voit que trois issues pour le manchot royal : « Soit les individus les plus costauds vont s’en sortir, soit l’espèce devra trouver d’autre ressources alimentaires, soit on assistera à la disparition des colonies ». C’est malheureusement la troisième hypothèse la plus vraisemblable, car si les « plus costauds » en réchappent, ce ne serait que temporaire, et dégressif puisque leurs descendants ne seront pas tous « costauds ».
Quant au changement de ressources, on voit mal ce que le manchot pourrait trouver d’autre dans la faune marine actuelle, sauf si les changements de température permettent la prolifération d’espèces qu’il trouvera comestibles. Autrement dit, l’espèce Aptenodytes patagonicus peut être d’ores et déjà considérée comme fortement menacée de disparition. Comme beaucoup d’autres. Voilà pour la science.
Mais toute recherche scientifique doit être menée dans le respect des règles éthiques propres à assurer le bien-être de l’animal, en lui épargnant douleur, souffrance, angoisse et dommage durable. Lorsque les animaux appartiennent aux espèces dites de laboratoire, ces règles sont d’application assez aisée, et leur effet sur l’animal est vérifiable. Mais qu’en est-il dans le cas des animaux d’espèces sauvages, dont on cherche en général à mieux connaître les circonstances d’une vie en liberté ?
S’il est (estimé) nécessaire que l’on doive aller au-delà des observations visuelles, cela conduit en général à commencer par des captures, inévitablement génératrices de stress majeur et souvent causes de lésions organiques (fractures). D’emblée, les règles éthiques sont gravement atteintes. Dès lors, l’utilisation d’animaux sauvages est soumise à des autorisations spéciales, que le code rural précise (art. R.214-91 et -92), et qu’il renforce s’il s’agit de spécimens d’espèces protégées (art. R.214-93).
Ces autorisations sont également exigées pour les prélèvements de tissu cutané ou la pose de balise. L’étude des manchots de l’Archipel Crozet a nécessité de telles autorisations ministérielles, accordées après avis favorable du comité d’éthique de l’Institut polaire français (IPEV) et du ministère français de l’Environnement quant aux méthodes de capture, de libération et de manutention des oiseaux. Les expérimentations ont été conduites sur des groupes de 6 à 15 manchots relâchés après que chacun ait été équipé d’un émetteur à antenne flexible ne dépassant pas 1,8 % du poids moyen des adultes, solidement fixé aux plumes du dos par des liens renforcés avec un adhésif, la procédure de l’équipement ayant pris en moyenne 15 min.
Mais le travail publié dans Nature Communications d’octobre 2015 mentionne que pour obtenir un aperçu détaillé sur l’activité d’alimentation des manchots, il a été implanté chirurgicalement dans l’œsophage de sept manchots un capteur de température à réponse rapide couplé à un enregistreur temps-profondeur-température ; c’est une technique qui avait précédemment montré sur des individus en captivité (3) que les capteurs de température à réponse rapide sont suffisamment sensibles pour détecter des proies de la taille des poissons les plus petits (1,8 g) capturés par les manchots.
La publication dans Nature ne donne aucun renseignement sur cette implantation chirurgicale, sur la technique opératoire, l’anesthésie, le réveil des animaux, leur état post opératoire ; elle ne fait que préciser (si l’on peut dire) que les oiseaux ont été recapturés après 9 à 23 jours passés en mer et les instruments récupérés, sans indiquer les modalités de la « récupération » chirurgicale de ces instruments de mesure.
Cette technique, pour le coup indéniablement invasive, avait nécessairement dû être approuvée par le comité d’éthique mentionné ci-dessus. Le moins que l’on puisse dire est que ce dernier a fait passer l’intérêt scientifique (supposé) avant l’intérêt de l’animal. Il est vrai que l’avis du comité d’éthique, comme l’autorisation du ministère de l’Environnement doublée de celle du ministère chargé de la recherche, avaient dû être sollicités bien antérieurement à 1992, c’est-à-dire conformément aux exigences du décret français de 1987.
Celui-ci n’avait pas exactement transposé la directive de 1986, qui imposait une autorisation particulière à chaque projet de procédure expérimentale : le décret français avait maintenu l’autorisation personnelle d’expérimenter instaurée en 1968, dans l’idée de former les expérimentateurs y compris sur le plan de l’éthique, puis de faire confiance à leur responsabilisation… De plus, avant que soit proposée la Charte d’Éthique qui devait être élaborée ultérieurement par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale, les comités d’éthique créés en France dans les établissements d’expérimentation étaient constitués de façon disparate, sans aucun schéma directeur (ce qui aurait dû être de l’initiative de la Commission nationale de l’expérimentation animale).
Et ayons le courage et l’honnêteté de l’écrire ici, ces comités étaient créés afin que les auteurs d’une publication scientifique puissent accéder à une revue scientifique « à comité de lecture », la condition étant que, pour être publié, le travail ait été supervisé par un comité d’éthique ! Peu importait, faute de règle, que ces comités d’éthique d’établissement fussent composés des chercheurs appartenant à l’établissement de recherche…
Cela comporte le doute d’une absence d’intérêts personnels. Il est plus que probable que, selon la réglementation d’aujourd’hui, issue de la directive de 2010 totalement axée sur l’éthique et le bien-être animal, l’expérimentation invasive qu’a été l’implantation chirurgicale d’un matériel sur des spécimens d’espèce protégée ne recevrait pas l’aval d’un quelconque des comité d’éthique actuels, dont les tâches (4) et la composition sont fixées par la réglementation : « parmi les membres d’un comité d’éthique doivent figurer trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie, trois personnalités désignées sur proposition d’organisations reconnues d’utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage » (5).
De plus, en qualité d’autorités compétentes, ainsi que le prescrit l’article 59 de la directive 2010, les comités d’éthique ne doivent connaître « aucun conflit d’intérêts dans l’accomplissement de [leurs] tâches », qu’il soit d’ordre professionnel, scientifique, financier, ou tout autre. Ce n’était pas (toujours) le cas des premiers comités d’éthique. Est-ce le cas général aujourd’hui ?
Ce serait à étudier, car d’une part il n’est pas certain que l’exigence d’indépendance de la directive soit d’application stricte et généralisée, et d’autre part il n’existe aucun moyen de s’en assurer, ainsi qu’il a été dit lors de la réunion des présidents de la centaine de comités d’éthique de France, tenue le 26 janvier dernier au ministère de la Recherche. Ce n’est guère rassurant…
Jean-Claude Nouët
- Centre d’Études Biologiques de Chizé, Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien de l’université de Strasbourg, Sorbonne Universités, Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive de Montpellier, National Institute of Polar Research à Tokyo.
- Bost CA et al. Large-scale climatic anomalies affect marine predator foraging behaviour and demography, Nature Communications, 27 October 2015
- Charrassin, JB et al. Feeding behaviour of free-ranging penguins determined by oesophageal temperature. Proc. Biol. Sci. 268, 151–157 (2001).
- Article R.214-134 du code rural et de la pêche maritime
- Article R.214-135 du code rural et de la pêche maritime
Article publié dans le numéro 89 de la revue Droit Animal, Ethique et Sciences.