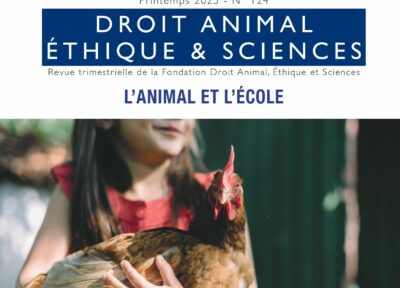La transformation des attitudes : l’homme comme objet
Pour comprendre les enjeux sous-tendant les justifications de l’exploitation animale, et du recours au vivant en général, il nous faut prendre un instant pour réaliser un bref tour des avancées qui ont été faites au cours de ces derniers siècles, en termes d’intégration de groupes au sein de la catégorie de ceux que l’on reconnaît comme « humains ». Cette évolution se reflète notamment dans les critères d’utilisation du vivant dans la recherche.
Depuis les débuts de la recherche expérimentale, les travaux scientifiques, de la psychologie à la médecine, se sont construits grâce au recours à des êtres vivants subissant une condition particulière, plus ou moins stressante. Au départ, il en allait de même pour les sujets humains. Ainsi, afin d’étudier le conditionnement des émotions, Watson et Rayner (1) ont induit chez un enfant de 9 mois des comportements de peur persistants. En psychologie sociale, l’on se rappelle de l’expérience de la prison de Stanford dont les auteurs, en 1971 (2), pour défendre l’hypothèse situationniste du Mal, ont délibérément prévu un contexte favorisant l’émergence de comportements violents, tant psychologiquement que physiquement, et laissé dégénérer une situation où leurs sujets ont été humiliés et violentés. Ces études, parmi tant d’autres, ont visiblement largement dépassé le cadre éthique dans lequel les chercheurs auraient été autorisés à travailler à l’heure actuelle.
Plus tard, la réflexion sur l’humain et sur la pertinence discutable de certains rapports coûts/bénéfices dans l’expérimentation a fini par inclure le bien-être physique et psychologique dans l’équation. Alors, nous nous sommes tournés vers l’exploitation de catégories auxquelles nous n’accordions pas toutes les qualités de l’homme moderne – par essence ou par tare morale ou intellectuelle (3) – pour fournir à la science quantité de sujets qui lui ont permis d’être aujourd’hui notre fierté, du moins en termes purs et durs d’avancement. Ainsi, les prisonniers (4) ou les minorités raciales (5) ont constitué des échantillons pratiques, en ce qu’ils rencontrent des difficultés à connaître ou faire défendre leurs droits. À cela, s’ajoute la pratique de l’expérimentation rémunérée, qui touche essentiellement les populations vulnérables lors d’études faisant encourir des risques aux participants (6).
Faisant écho à l’évolution des conceptions de l’opinion publique ainsi qu’à des mouvements politiques et sociaux, ces différentes catégories seront progressivement pleinement réhumanisées et protégées par les conventions et lois réglementant l’expérimentation humaine. En parallèle, les protocoles expérimentaux autorisés seront eux-mêmes réduits et soumis à approbation. En ce qui concerne la médecine, par exemple, chaque individu se voit désormais octroyer des droits vis-à-vis de l’expérimentation alors que l’expérimentateur semble plus strictement contraint par des limitations – ou au moins des injonctions à utiliser son bon sens et son sens moral pour encadrer son expérimentation (Déclaration d’Helsinki, 2008, § 3, 4, 6, 11 et 21) (7).
Effectivement, en 1947, le Code de Nuremberg et, en 1964, la Déclaration d’Helsinki, entre autres, ont érigé des codes s’ancrant dans une réflexion amorcée bien plus tôt et définissant un cadre éthique à l’expérimentation humaine, cadre qu’il paraît désormais juste de respecter si l’on considère chaque être humain comme un être sensible dont il faut respecter l’intégrité physique et morale. Les hommes sont donc théoriquement protégés par des lois, où il apparaît même que le bien-être de l’individu-sujet devrait primer sur l’intérêt de la science ou de l’espèce (Déclaration d’Helsinki, § 6 et 11, et moins nettement 18 et 21). On en conclut donc « naturellement » aujourd’hui que l’expérimentation ne peut pas sacrifier à n’importe quelle cause le bien-être et le devenir d’un individu, quelles que soient ses particularités (p.ex. cognitives, origine ethnique, milieu social…). En ce qui concerne notre espèce, la fin ne semble donc pas justifier les moyens.
Ces quelques rappels d’histoire humaine sont la preuve concrète que les discours et attitudes vis-à-vis de différents groupes humains n’ont pas toujours été les mêmes qu’aujourd’hui. Ce changement est radical car il s’agissait là d’humaniser pleinement des groupes auparavant exclus de la considération réservée au groupe dominant. Cette transformation représente un pas formidable pour l’éthique humaine pour au moins deux raisons majeures. D’abord, en raison de tout ce qu’elle implique en termes de reconnaissance de droits et de vivre-ensemble, c’est-à-dire de changements profonds dans la société et les mentalités qui y ont cours, mais également en raison de l’effort que nécessite le dépassement de la culpabilité et de la honte liés à la lenteur de cette évolution et du traitement qui a été réservé à ces catégories pendant si longtemps, effort considérable fourni au nom des valeurs supérieures que sont la morale et la justice.
Précision de la démarche
Ces changements radicaux de considération accordée à des groupes humains montrent qu’il est possible, par une évolution des attitudes et, en lien, du droit, de modifier du tout au tout notre rapport à un être vivant et, par là, la conception que nous avons du monde qui nous entoure.
Sans vouloir l’humaniser, puisque cela semble être une des grandes craintes contemporaines, il apparaît donc possible d’envisager un changement radical – mais non moins progressif – de l’attitude générale que l’homme adopte envers l’animal. Il est effectivement essentiel de garder à l’esprit que l’objectif n’a jamais été de faire des animaux des hommes, même si l’inverse est une réalité biologique, mais de permettre aux animaux d’être respectés en tant que tels et de leur reconnaître une place en soi et non plus relativement à l’homme. En effet, il est désormais reconnu que la différence entre l’homme et l’animal est une différence de degré et non de nature (8, 9). Cette gradation pourrait par exemple se refléter au niveau du statut légal. S’il est vrai que reconnaître une responsabilité morale à l’animal n’a jusqu’ici pas été un franc succès (rappelons-nous des procès d’animaux au Moyen-Âge (10, 11), il devrait être possible, avec quelques efforts, d’admettre que les animaux puissent être objets de droits, sans en être sujets. Cette idée encore largement contestée aujourd’hui est étonnante, si l’on considère qu’à l’inverse, nous continuons au quotidien à ne les considérer que comme objets dans bien des domaines, de la science aux loisirs – ce que Porcher (12) dénonce comme un « processus de désubjectivation » – indiquant ainsi que ces deux statuts peuvent être dissociés.
Afin de pouvoir accélérer un changement de regard, c’est-à-dire une mise en réflexion, que ce soit par le militantisme ou la simple information-sensibilisation, il est nécessaire de savoir précisément à quelles conceptions, croyances et peurs réelles nous sommes aujourd’hui confrontés. Un changement sociétal global consistera effectivement à amener et accompagner chaque citoyen à prendre conscience, à son rythme, des croyances et émotions qui régissent son attitude et son comportement effectif personnel en regard de la question animale et des implications de ses comportements et choix quotidiens.
Et l’animal dans tout ça ? Discours et raisonnements
Au 18ème siècle, le philosophe Thomas Taylor s’est efforcé de démontrer comment les revendications de droits faites pour les femmes et leurs justifications étaient tout aussi applicables aux animaux, et par là, nécessairement ridicules (13).
Un peu plus récemment, le racisme et le sexisme se sont précisément basés sur une prétendue différence d’intelligence pour justifier un traitement différencié. Puis, suite à l’évolution des mentalités, découlant notamment de l’évolution des savoirs, nous avons là aussi modifié les frontières. Toutefois, l’évolution de nos connaissances ne se limite pas aux différents groupes humains, elle concerne également notre environnement, en particulier le monde animal. Il peut dès lors paraître étonnant que cet approfondissement de nos connaissances n’aille pas de pair avec un changement attitudinal plus rapide et plus global à son égard, ou au moins à une remise en question plus généralisée qu’elle ne l’est actuellement. Le parallèle entre la libération de la femme et l’abolition de l’esclavage, d’une part, et la libération animale, de l’autre, est d’ailleurs un thème récurrent en philosophie et en éthique, suggérant ainsi qu’il n’est ici question que d’une simple extension de la considération accordée au vivant.
Mais bien avant cela, déjà chez Rousseau, puis Bentham, existe l’idée que c’est la capacité à souffrir de l’animal qui fait qu’il a le droit à une considération morale. Pour ces auteurs, donc, nul besoin d’aller au-delà en évoquant des notions complexes comme la conscience ou l’intelligence (14). Pour Zozaya (15) d’ailleurs, il n’existe « qu’une seule cruauté, la même pour les hommes et pour les bêtes », la vraie question serait ainsi celle de faire reculer ce mal, plutôt que de déterminer qui il impactera le plus. Mais nous voilà déjà des siècles plus tard et ces arguments ont toujours cours.
Ainsi, à travers l’histoire, un nombre fini et en constante évolution de droits est attribué aux membres d’une espèce, sur base de ses spécificités. Différentes caractéristiques ou productions de l’homme sont régulièrement utilisées par le grand public (mais pas seulement), de manière parfois naïve, pour définir l’essence humaine. Citons rapidement : des capacités cognitives exceptionnelles dont témoigne notre avancement technologique, un langage parlé présentant différentes particularités, la capacité à penser à (voire, pour certains, à être pensé par) un ou des dieux, une gamme étendue et pointue d’émotions, l’intentionnalité, le sentiment d’appartenance, etc. En parallèle, et relevant directement des valeurs et du rapport à l’autre, l’altruisme, un certain sens de la justice et le sens moral apparaissent comme les critères ultimes de notre humanité.
Dans ces conditions-là, et par souci de justice et de cohérence avec notre système moral – et donc par respect précisément de ce par quoi nous définissons notre humanité – il serait pertinent de reconsidérer quelques-unes de nos positions. D’abord, sont-ce vraiment là des spécificités humaines ? En effet, et sans être exhaustif, la coopération (16) et les compétences (pro)sociales sont particulièrement bien développés chez certaines espèces, notamment les chimpanzés. De la même manière, des animaux se sont montrés capables de prendre l’autre en considération, que ce soit pour mettre en place des comportements empathiques comme la consolation (17), des comportements de dissimulation tenant compte des informations dont l’autre est en possession (18), pour venir en aide à quelqu’un (19) ou réagir différemment en fonction de l’intention perçue (20). Un certain sens de la justice plus ou moins immédiat (21) ou s’inscrivant dans l’historique d’une relation (22) ne semblent plus, eux non plus, être l’apanage de l’espèce humaine. De plus, la résolution de problèmes (23), le recours à des outils (24) ou la transmission culturelle d’un savoir (25), sont également des compétences partagées avec d’autres espèces.
Ensuite, en quoi l’un ou l’autre de ces traits, ou leur combinaison particulière, permettrait de justifier l’asservissement d’une infinité d’êtres vivants, ainsi que leur exploitation ? Est-ce que le simple fait d’avoir les moyens techniques d’une domination la rend juste ? L’histoire humaine moderne tend à faire penser que non. Est-ce que la « loi du plus fort » qui soutient cette captivité et cette exploitation non librement consenties est en accord avec les principes moraux dont nous nous disons porteurs
De plus, en réponse constructive à nos erreurs historiques vis-à-vis d’autres hommes, ne devrait-on pas, dans le doute, envisager de remplacer cette hiérarchisation des espèces – qui permet les crimes les plus odieux – par une hiérarchisation des valeurs et des droits, qui permettrait, elle, d’assurer un minimum de décence et de dignité à la vie en général ?
Directement liées à cela se trouvent les questions des fins et des moyens. D’abord, au regard des priorités qui organisent nos interactions avec l’animal, c’est-à-dire la plupart du temps la rentabilité et l’efficacité, n’y a-t-il pas des domaines qui ne méritent assurément pas ce coût en termes de vie et de qualité de vie animale ? Par exemple, l’utilisation d’animaux pour les loisirs ou en cosmétique, revient fondamentalement à valoriser plus notre plaisir ou notre apparence que la vie elle-même et la qualité de vie d’autres individus, c’est-à-dire à faire prévaloir du superficiel sur de l’essentiel. Cette hiérarchisation relève d’un choix moral discutable. Ensuite, il est nécessaire également de faire un choix parmi les méthodes disponibles : d’abord, il existe bien souvent des alternatives au recours à l’animal, ensuite il existe différentes manières de le traiter. Porcher (26), par exemple, bien qu’elle tolère la mise à mort d’animaux dans le but de se nourrir, dénonce les conditions d’élevage qui ont fait que « tuer les animaux est devenu un crime […] [en] indéniable conséquence des procédures du travail dans les systèmes de production industriels, dans lesquels les animaux sont traités d’une façon moralement insupportable pour un citoyen mettant en jeu son sens moral dans ses choix de consommation […] ». Bien sûr, certaines alternatives à l’exploitation animale sont plus coûteuses en temps, en personnel et en argent, mais le respect d’êtres vivants ne devrait-il pas primer sur les coûts financiers ? La vie ne devrait-elle pas primer sur le matériel ?
Bien sûr, l’argument ultime sera toujours le recours à la différence catégorielle homme vs. animal ; il n’en reste pas moins que cette frontière se révèle de plus en plus fine (8), même pour les scientifiques, et qu’au-delà de cela, nous n’arrivons plus à ériger sur base d’arguments rationnels et scientifiques, sur des critères et des valeurs qui vaudraient de manière absolue, y compris en s’appliquant à notre espèce, une barrière suffisante pour nous permettre d’assumer consciemment et ouvertement les nombreuses implications de notre rapport à l’animal.
Néanmoins, dès lors que les droits accordés à l’humain se fondent sur les qualités qu’on leur concède et dès lors que nous arrivons au constat qu’à défaut d’accepter que les animaux sont des êtres sensibles, socialement attachés et intelligents (car il reste à l’heure actuelle beaucoup d’opposition à cette thèse), nous ne pouvons pas prouver qu’ils ne le sont pas, ne devrions-nous pas, à tout le moins, leur laisser le bénéfice du doute ? C’est à tout le moins à cette précaution qu’encouragent les défenseurs de la « présomption de sensibilité », comme l’a notamment fait Nouët au nom de la LFDA (27).
Au minimum, ne devrions-nous donc pas, par cohérence avec le système de valeurs dont nous nous réclamons, envisager une restructuration de nos priorités basée sur une réflexion un peu plus altruiste et qui aurait le mérite de replacer l’homme à la place qui lui revient, c’est-à-dire au sein d’un écosystème fait d’espèces interdépendantes ? Cela devrait nous pousser à admettre, d’une part, que dans certains cas, le sacrifice animal n’en vaut pas la peine et, d’autre part, que, lorsque nous décidons de maintenir une utilisation de l’animal, il est nécessaire de repenser les conditions dans lesquelles les individus sont maintenus et de revoir à la hausse les conditions minimales requises pour viser leur bien-être et, plus largement, de réfléchir le rapport homme-animal.
Sarah Lux
(1) Watson JB & Rayner R. (1920). Conditioned Emotional Reactions. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1-14.
(2) Haslam SA & Reicher SD. (2012). Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and Zimbardo’s Studies Really Show. PLoS Biology 10(11): e1001426.
(3) Pour plus de détails, se référer aux travaux sur la physiognomonie, les théories raciales, les travaux portant sur le caractère et les dispositions des personne présentant différents t roubles (e.g. alcoolisme, retard mental) et autres constructions pseudo-scientifiques visant à hiérarchiser des groupes humains les uns par rapport aux autres.
(4) Hornblum AM. (1997). They were cheap and available: Prisoners as research subjects in twentieth century America. British Medical Journal, 315(7120), 1437-1441.
(5) Katz RV et al. (2008). Awareness of the Tuskegee Syphilis Study and the US presidential apology and their influence on minority participation in biomedical research. American journal of public health, 98(6), 1137-1142.
(6) Moreno JD. (1998). Convenient and captive populations. Beyond consent: Seeking justice in research, 111-130. Cité par Bernstein, M. (2003). Payment of research subjects involved in clinical trials is unethical. Journal of neuro-oncology, 63(3), 223-224.
(7) Déclaration d’Helsinki: Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains. Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par la 59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, Corée, Octobre 2008.
(7) Darwin C. (1871). The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1st ed.). London: John Murray.
(8) Nouët JC & Chapouthier G. (2006). Humanité, Animalité: quelles frontières ? Éditions connaissances et savoirs, Paris.
(9) Knecht C. (2011). Animalement vôtre : Procès d’animaux, histoires d’hommes. Éditions Pourquoi viens-tu si tard ? Nice.
(10) Vilmer JBJ. (2011). Éthique animale. Paris : P.U.F.
(11) Porcher J. (2009). Bêtes de somme. Pack animals Revue Ravages, 3, 115-135 citée par Porcher J. (2011). Vivre avec les animaux : Une utopie pour le XXIe siècle. Paris : Éditions la Découverte.
(12) Singer P. (2012). La libération animale, trad. Paris : Éditions Payot et Rivages.
(13) Vilmer, préface à Singer, 2012.
(14) Zozaya, A. (1910) cité par Singer, P. (2012). La libération animale, trad. Paris : Éditions Payot.
(15) Mitani JC, Merriwether A & Zhang C. (2000). Male affiliation, cooperation and kinship in wild chimpanzees. Animal Behaviour, 59(4), 885-893.
(16) Romero T et al. (2010). Consolation as possible expression of sympathetic concern among chimpanzees. PNAS, 107(27), 12110-112115.
(17) Hare B et al. (2000). Chimpanzees know what conspecifics do and do not see. Animal Behaviour, 59(4), 771-785.
(18) Whiten A et al. (1999). Cultures in Chimpanzees, Nature, 399(6737), 682-685.
(19) Call J et al. (2004). “Unwilling” versus “unable”: chimpanzees’ understanding of human intentional action. Developmental Science 7(4), 488– 498.
(20) Brosnan SF & de Waal FBM. (2003). Monkeys reject unequal Pay. Nature, 425(6955), 297-299.
(21) Cheney DL. (2011). Extent and limits of cooperation in animals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(Supplement 2), 10902-10909.
(22) Heinrich B, & Bugnyar T. (2005). Testing Problem Solving in Ravens: String‐Pulling to Reach Food. Ethology, 111(10), 962-976.
(23) Biro D et al. (2003). Cultural innovation and transmission of tool use in wild chimpanzees: evidence from field experiments. Animal cognition, 6(4), 213-223.
Ottoni EB & Izar P. (2008). Capuchin monkey tool use: overview and implications. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 17(4), 171-178. (24) Whiten et al., 1999
(25) Porcher J. (2011). Vivre avec les animaux : Une utopie pour le XXIe siècle. Paris : Editions la Découverte. (p. 115)
(26) Nouët JC. (2015). Le code civil met l’animal à un régime trop sec. Droit Animal, Éthique & Sciences, 85, 7-8.
Article publié dans le numéro 90 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.