Compte rendu de lecture
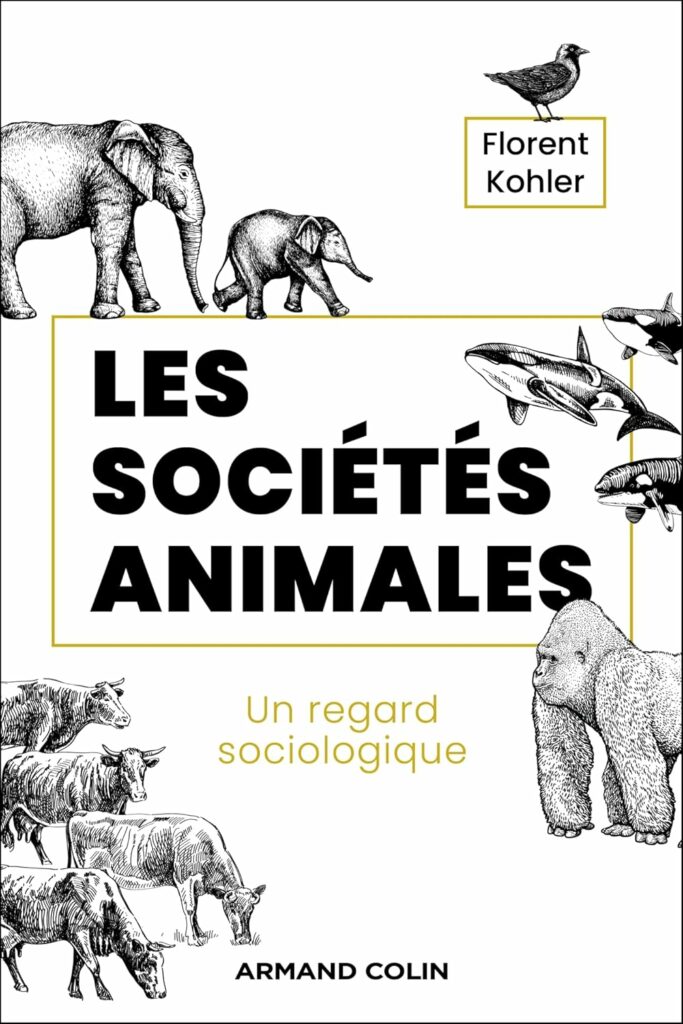
Dans son analyse des sociétés animales, le sociologue et anthropologue Florent Kohler, maître de conférences à l’université de Tours, adopte ici une méthode très originale, celle appliquée classiquement aux sociétés humaines. « Parler de sociétés animales, c’est d’abord parler de sociétés » (p. 7). Il faut, dès le départ, dépasser « une double terminologie qui paralyse les études animales : jambe/patte, amour/attachement, amitié/proximité […] Comment comparer des choses qui n’ont pas le même nom ? » (p. 7). « Les mêmes outils conceptuels doivent être employés pour décrire les mêmes réalités » (p. 8), voire s’appuyer sur « un anthropomorphisme mesuré qui permet d’appréhender les états émotionnels sans négliger que chaque animal évolue dans un monde différent du nôtre » (p. 8). « J’explore depuis près de vingt ans les concepts des sciences humaines […] qui seraient applicables aux sociétés animales » (p. 13).
La première partie du livre expose l’analyse détaillée de ces concepts et des méthodes utilisées par l’auteur. « L’anthropomorphisme critique ou de questionnement » (p. 23) qui permet « d’élargir le champ de la sociologie aux sociétés animales répondrait également à la demande de ceux, parmi les éthologues, qui aspirent à un rapport moins distancié, donc plus intime, à l’animal » (p. 30). Le cadre conceptuel de l’ouvrage, issu de la sociologie et de l’anthropologie, renvoie au fait social, » un moment d’interaction révélateur d’enjeux et de rapports sociaux » (p. 37) où « l’individu est déterminé par le(s) milieu(x) sociaux dans lesquels il évolue » (p. 39) et tributaire d’un langage, voire d’expressions non verbales, que l’on peut observer et analyser. Dans la comparaison avec les animaux, l’auteur souligne l’importance considérable prise par la zoosémiotique, qui est, elle aussi, un catalogue « des signes et des signaux » (p. 45) échangés par les animaux donc d’expressions langagières ou non, comparables aux expressions humaines.
Ce qui nous amène à la seconde partie, qui vise à définir les « formes de l’organisation sociale » (p. 77). Les structures familiales se trouvent, par exemple, dans « l’amour familial des éléphants d’Afrique » (p. 86), dont les manifestations émotionnelles entre les membres de la troupe peuvent être très grandes ou encore dans le comportement des gorilles de montagne, chez qui « le sel de leur existence, c’est la recherche du bien-être individuel et collectif » (p. 96). Les hyènes donnent un exemple de structure clanique, puisqu’un clan « forge volontairement des normes et des usages qui le différencient des concurrents » (p. 99). Chez les hyènes, les individus se reconnaissent entre eux et le territoire constitue un « facteur de cohésion » (p. 103). Chez les cachalots, les clans se distinguent par une spécialisation alimentaire. Enfin les choucas ou les babouins offrent des exemples de structures communautaires complexes et hiérarchisées.
La troisième partie est consacrée aux expressions du lien social, et particulièrement l’expression des émotions, ces traits sociaux si importants, dont on a longtemps voulu priver les animaux et que Kohler analyse en détails. L’auteur étudie aussi le conformisme, car il est intéressant pour un individu d’adopter le comportement général du groupe ou, pour un jeune, celui enseigné par ses parents, voire « à se plier aux normes sociales en copiant le comportement des autres (simplement) parce que ce comportement manifeste l’engagement social » (p. 152), ce qui aboutit à une forme de « normalité sociale » (p. 156) dans le groupe. Cette normalité peut même faire appel des rites ou des comportements formels qui maintiennent la cohésion du groupe sans pour autant traduire une émotion individuelle du sujet. Ainsi existent d’importants rituels de salutation, de soumission ou de dominance hiérarchiques, essentiels dans le groupe, voire le jeu où l’on mime un comportement « comme si » c’était une vraie situation.
Enfin la dernière partie du livre présente les relations inter-espèces. « Ces relations sont multiples, et les plantes en sont parties prenantes » (p. 174) : symbiose, parasitisme, mutualisme (échange de services entre espèces), commensalisme (partage harmonieux des ressources) ou au contraire compétition, voire amitié » qui s’applique particulièrement aux enfants » (p. 174). Dans ce cadre, les relations complexes entre proies et prédateurs font l’objet d’une analyse plus détaillée de même que les communautés multi-espèces comme les récifs coralliens, où l’on observe « de nombreuses symbioses entretenues par tous les organismes » (p. 189). L’auteur montre aussi comment des communautés multi-espèces peuvent se construire autour de l’homme, y compris dans un exemple aussi commun qu’un jardin : « un jardin est tridimensionnel pour de nombreuses espèces (oiseaux, insectes, écureuils lézards). Du sol jusqu’à la canopée se situent de multiples milieux » (p. 203) où, « partageant l’espace et la temporalité des habitants du jardin, je ne suis pas un étranger » (p. 205). Une communauté multi-espèces qui est donc très proche de nous dans notre vie quotidienne.
Ce livre très original, qui vise à montrer la remarquable parenté des sociétés animales avec les sociétés humaines, intéressera tous ceux que se passionnent pour le comportement animal.
Georges Chapouthier



