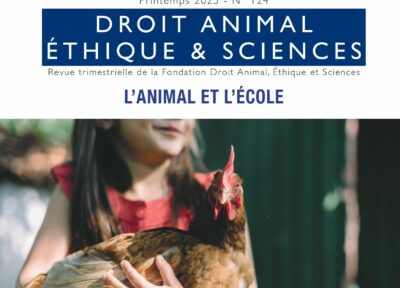Dans Libération du 8 novembre 2007, le journal publie, sous la plume de la philosophe Élisabeth de Fontenay, un bel article dénonçant les fausses prestations des apôtres de la corrida, dans le quel elle fait référence à l’ouvrage d’Élisabeth Hardouin-Fugier, administrateur de la Fondation Ligue française des droits de l’animal.
« C’est en 1853 que la corrida fut implantée en France par Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III. Ce dernier ne s’est donc pas contenté de violer la Constitution de 1848, il a fait bon marché de la loi Grammont votée en 1850, cette première mesure de protection animale que la gauche républicaine avait défendue contre la droite cléricale. Était-elle plus belle ou l’était-elle moins, la feria, avant que, vers 1930, on impose l’usage du caparaçon ? Les festivités sanglantes commençaient alors, comme le souligne Élisabeth Hardouin-Fugier dans Histoire de la corrida en Europe du XVIIe au XXIe siècle, par le massacre des chevaux que montaient les picadors. Ces animaux, affamés, hébétés, les yeux bandés, incapables d’esquiver la charge se faisaient immanquablement éventrer et, à moins d’être immédiatement recousus, ils se prenaient les pieds dans leurs entrailles.
Ernest Hemingway aura eu la bassesse d’écrire que, dans la tragédie de la mort du taureau, celle du cheval relevait plutôt du comique et Michel Leiris, que « l’ignoble sang des chevaux » représentait les menstrues féminines. Interrogé sur son rapport à Michel Leiris, Jacques Derrida, qui avait accepté la présidence d’honneur du Comité radical anticorrida, avait répondu: « Je peux aimer ou admirer tels textes de Leiris sans cesser de me poser des questions sur le désir et l’expérience de Leiris lui-même. »
On rappellera du reste que Michel Leiris et Henry de Montherlant ont fini par dénoncer le cabotinage de la plupart des toreros et le verbiage héroïco-esthétique des aficionados. Certes, j’accorderai à ceux-ci l’incontestable beauté d’un spectacle qui s’est imposé comme une cérémonie grandiose.
Mais ce constat n’empêche aucunement de demander si le fait de procéder selon des rites annule la responsabilité morale d’une torture mortelle infligée en vue d’un pur plaisir. Eugène Delacroix, qui a représenté des acteurs de l’arène, n’a jamais peint de corrida et il a écrit dans son journal que « là où coule le sang, l’art est impossible ».
Les apôtres de la corrida disent, de surcroît, que son abolition constituerait une faute écologique en ce qu’elle mettrait fin à l’élevage des taureaux sauvages, race qui concourt à la diversité des espèces. Or, il faut savoir que la zootechnie n’a pas moins créé et cultivé le taureau dit de combat que le bœuf du Charolais si méprisable aux yeux des zélateurs du « toro bravo ». Celui-ci ne combat pas de nature comme un chien chasse de race puisqu’il est méthodiquement entretenu dans une « hostilité familière ». Les taureaux sauvages sont à peu près élevés comme on élève des faisans pour les tirer et, en liberté, ils n’attaquent guère les hommes, sauf circonstances exceptionnelles. Ce qui rend le taureau non pas « brave » mais furieux c’est son conditionnement, sa contention lors du transport et son enfermement dans le toril.
Les taureaux sauvages sont à peu près élevés comme on élève des faisans pour les tirer et, en liberté, ils n’attaquent guère les hommes, sauf circonstances exceptionnelles. […] Comment explique-t-on en effet que certains d’entre eux refusent le combat à tel point que pour les exciter, on lâchait naguère sur eux les molosses des abattoirs de Séville ?
C’est avec la justification éthique de la corrida qu’on touche au comble de la supercherie. Les aficionados cultivés se réclament d’une morale aristocratique d’inspiration stoïcienne, ils exaltent la virilité héroïque de deux êtres exceptionnels, le toro et le torero. Selon eux, cette éthique de la lutte à mort irait à l’encontre de la tranquillité bourgeoise et de ses pleurnicheries sur les droits. Ainsi opposent-ils la mort debout du taureau dans l’arène à la mort passive et ignominieuse des bœufs à l’abattoir. Ce mode de légitimation a quelque chose de grotesque. D’abord parce que parler de la bravoure des toros relève d’une pure projection.
Comment explique-t-on en effet que certains d’entre eux refusent le combat à tel point que pour les exciter, on lâchait naguère sur eux les molosses des abattoirs de Séville ?
Ensuite, parce qu’en dépit de Picasso, ce culte de l’héroïsme viril pue son « Viva la muerte ! » fasciste. Enfin, parce que les spectateurs se contentent d’être assis et de regarder. On ne nous fera quand même pas prendre le voyeurisme collectif pour un acte de courage.
La corrida est un spectacle qui consiste à infliger au taureau des tortures savantes, de manière à retarder le moment fatal. Les harpons des banderilles plantées sur son dos l’ensanglantent et entament ses muscles un peu plus à chacun de ses mouvements mais les blessures n’en sont pas mortelles. C’est au bout de vingt minutes que, les poumons remplis de sang, tombant à genoux – et non debout ! –, il reçoit l’estocade, laquelle ne met pas fin à son supplice puisqu’il faut encore que l’achèvent les puntilleros armés de couteaux : dans l’arène mais à l’abri des regards.
Si Hugo et Schoelcher ont jugé capital de porter au nombre de leurs combats l’opposition à la corrida, c’est bien qu’il y a quelque chose de politique au cœur de cet engagement contre la magie du sang, de la volupté et de la mort.
Je suis absolument contraire, écrivait Zola, aux courses de taureau, qui sont des spectacles dont la cruauté imbécile est, pour les foules, une éducation de sang et de boue.