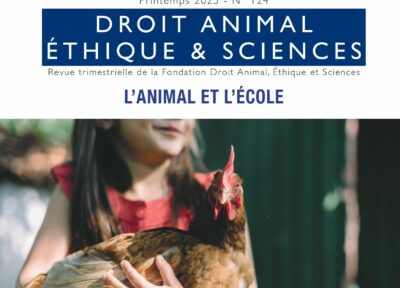Table ronde dans le cadre du colloque « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté » organisé par la LFDA le 16 novembre 2021 au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Par Laurence Parisot, Vice-présidente de la LFDA, en compagnie de Loïc Obled, directeur-général de l’Office français de la biodiversité, Marie-Bénédicte Desvallon, Avocate au Barreau de Paris et créatrice de la commission ouverte sur le droit de l’animal et Manon Delattre, juriste pour l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS).
 © Gabriel Legros
© Gabriel Legros
Télécharger les actes du colloque au format PDF.
Laurence Parisot
Merci infiniment, Muriel, pour cet exposé lumineux sur les incohérences du droit, et pour cette proposition tout à fait importante de la LFDA. Cette proposition est présentée le jour même où l’Assemblée nationale adopte un texte qui constitue un vrai progrès pour la condition animale en France. Ainsi, je voudrais tout particulièrement remercier Loïc Dombreval pour sa contribution, mais aussi les autres rapporteurs de ce texte, et notamment Dimitri Houbron qui est présent également, et Laetitia Romeiro Dias qui a aussi contribué. Merci à vous. On est toujours impatient quand on est engagé, militant ou sensible, comme je pense vous l’êtes tous. On se dit toujours que ça pourrait être mieux, mais si on prend un peu de recul, on réalise qu’il y a là déjà quelque chose de tout à fait significatif qui vient d’être accompli.
Pour prolonger cette question juridique, qui est fondamentale, on parle de science depuis ce matin, on parle de modèle économique, évidemment, pour faire évoluer les choses, mais le droit peut encadrer, et son évolution peut apporter des progrès décisifs. Pour approfondir cette question juridique, nous avons autour de la table pour ce débat Loïc Obled. Loïc, vous êtes le directeur-général de l’Office français de la biodiversité (OFB), et vous êtes le garant du bon comportement de chacun. Vous nous expliquerez par la suite exactement ce que vous faites, dans quelles conditions vous le faites et aussi quelles sont les limites à ce que vous pouvez faire. Puis nous avons Marie-Bénédicte Desvallon, qui est avocate, et qui anime au Barreau de Paris – et ça me semble tout à fait important – la commission ouverte « Droit et animaux », spécialisée sur la question du droit animal, ce qui est une nouveauté. Ça fait déjà quelques années que ça existe, mais c’est tout à fait intéressant et rassurant de voir que les avocats s’organisent pour mieux réfléchir à cette question. À ma droite, une praticienne combattante au sein d’une association pour laquelle j’ai beaucoup d’affection : Manon Delattre, vous êtes juriste pour l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). C’est donc à ce titre que vous avez connu beaucoup de cas et que vous avez acquis une expérience à nous faire partager. Ce que je vous propose, c’est que vous disiez en quelques minutes vos sentiments, vos réflexions, vos observations, mais surtout vos expériences sur le droit et l’animal, et particulièrement l’animal en liberté.
On peut commencer par vous, Maître, pour que vous nous disiez, en tant qu’avocate spécialiste de la protection animale, ce que vous avez pu observer et ce que vous pouvez espérer aussi pour l’avenir.
Marie-Bénédicte Desvallon[1]
Merci tout d’abord pour votre invitation. Si le Dictionnaire Larousse définit le caractère sauvage d’un animal comme « une espèce animale non domestique vivant en liberté dans la nature, il n’existe pas de définition juridique de l’animal sauvage. On parlera d’animal non domestique, qui d’ailleurs n’est pas distingué dans sa définition selon qu’il est libre ou captif. Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi la modification par sélection de la part de l’homme. Les animaux domestiques sont, comme vous le savez, régis par le Code rural, alors que les animaux sauvages relèvent du Code de l’environnement. Au sein des animaux sauvages, on distingue les espèces protégées, les espèces chassables ou alors qui relèvent de la pêche, les animaux susceptibles de provoquer des dommages, autrefois dits animaux « nuisibles ». Effectivement, on ne parle pas d’individus, mais on parle d’espèces. L’animal sauvage est, comme il a été évoqué par Mme Falaise, un res nullius – je ne reviendrai pas sur cette définition. La législation française ne prévoit pas de sanction pour maltraitance d’un animal non domestique à l’état de liberté. La question centrale est bien sûr la question de la sensibilité de l’animal. Que signifie cette notion ? Qu’est-ce qu’elle comporte ? Dans quel sens doit-on l’appréhender ? Au niveau européen, le Traité de Lisbonne est venu consacrer le caractère sensible de l’animal à l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Qu’est-ce qu’il nous dit ? Il nous dit que « lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles », avec les exceptions habituelles qui sont les traditions culturelles et les rites religieux. Vous noterez que l’environnement n’est pas visé par le texte. Ce qui a amené la doctrine à considérer que les animaux sauvages ne sont pas reconnus comme des êtres sensibles.
En droit français, cela a été évoqué, l’article L214-1 du Code rural adopté en 1976 et l’article 515-14 du Code civil adopté en 2015 reconnaissent la sensibilité des animaux. Pour une partie de la doctrine, cet article s’inscrit et se limite toujours aux animaux domestiques. Pourquoi ? Parce que l’article est placé sous le livre II intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». Ces deux textes majeurs en droit français sur la reconnaissance de la sensibilité de l’animal ont en commun la référence au caractère approprié de l’animal. Et comme vous l’avez dit Mme Falaise, il semblerait que la considération de la, ou plutôt des sensibilités des animaux non domestiques, ne résulterait pas de leur nature biologique, mais serait inhérente à leur appropriation par l’homme. C’est donc le rattachement à la propriété de l’homme qui conférerait un caractère sensible. Ainsi, la domestication par l’homme rendrait les animaux sauvages doux comme des agneaux, tandis qu’un gibier d’élevage deviendrait une bête féroce une fois libéré de la main de l’homme.
Sur la considération scientifique, je ne m’engagerai pas sur ce terrain si ce n’est en évoquant deux dates : en 2019, M. Chapoutier, à l’occasion du dernier colloque de la LFDA, expliquait qu’« il y a certains animaux qui ne sont pas sensibles du tout sur le plan nerveux, en l’occurrence les éponges. En l’état actuel d’avancement des sciences » – il ajoutait : « sont dotés de combinaisons nerveuses les vertébrés, les mollusques céphalopodes, peut-être des crustacés décapodes, et peut-être aussi les abeilles ». En 2021, ces derniers jours, vous aurez peut-être relevé l’annonce d’une découverte relayée par certains médias. Une récente étude du laboratoire allemand Heidelberg apporte une avancée majeure sur la reconnaissance des origines d’homo sapiens : Le cerveau humain viendrait en droite ligne d’une éponge. Je laisserai donc les scientifiques tirer les conclusions qui s’imposent.
Revenons sur la portée juridique de la reconnaissance du caractère sensible de l’animal. À cette notion de sensibilité est rattachée celle de la capacité à ressentir la souffrance, une certaine conscience de la douleur, et d’autres éléments cognitifs qui ont été développés ce matin. Pour autant, et si la jurisprudence tend à sanctionner aujourd’hui plus sévèrement les actes de maltraitance, il faut savoir que l’animal domestique n’est pas reconnu comme une victime non plus. L’animal n’est pas protégé en tant qu’individu. C’est finalement la sensibilité de l’humain, propriétaire de l’animal, qui est indemnisée dans le cadre des sanctions selon les peines et les condamnations prononcées. Il en est différemment pour les animaux sauvages. Il convient toutefois de noter qu’il y a, certes de manière non expresse mais plutôt indirecte, une certaine reconnaissance d’une sensibilité, notamment dans le cadre de l’expérimentation animale. Ainsi, dans le code de l’environnement, certaines expériences sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité sont soumises à une autorisation lorsqu’elles sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse, ou des dommages durables. De même en matière de chasse : c’est le ministre chargé de la chasse qui fixe les conditions d’utilisation des pièges, notamment ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes. On voit bien dans cela que c’est dans le prisme de la sensibilité humaine finalement, et non pas celle de l’animal, que la notion de sensibilité est appréhendée.
Sur le plan des évolutions européennes, qui sont véritablement le guide précurseur de l’évolution du droit de l’animal en France, apparaissent des sanctions qui sont prononcées à l’encontre de l’État français, notamment sur certaines pratiques de chasse. Il vous a déjà été mentionné la question des pièges à mâchoires, probablement également la question de l’affaire des produits dérivés du phoque. L’un des moyens juridiques pour justifier l’interdiction de leur importation portait sur les considérations d’ordre moral, y compris les préoccupations portant sur le bien-être des animaux. Le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) lui-même a prévu des exceptions sur la liberté de commerce, sur les restrictions nécessaires à la protection de la moralité publique, et distingue la protection de la santé, de celle de la vie des animaux. Toujours dans cette affaire des produits dérivés du phoque, il a été avancé que ces animaux sont des animaux sauvages sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur, et d’autres formes de souffrance.
Une avancée récente qui me semble importante de souligner aujourd’hui est celle qui résulte de l’affaire des questions préjudicielles portées par les associations LPO et One Voice sur la question de la chasse à la glu. Dans cette affaire, l’avocate générale soulignait au point 36 de ses conclusions : « Il convient de prendre en considération l’article 13 du TFUE [Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne]. » Or, cet article, comme évoqué précédemment, ne concerne pas normalement les animaux sauvages, puisque l’environnement n’est pas cité. En invoquant l’article 13 dans le cas précis de la chasse à la glu, on peut considérer qu’il y a une extension et une reconnaissance du caractère sensible des animaux sauvages que sont les oiseaux. C’est donc pour moi une véritable avancée qui je l’espère sera transférée dans d’autres jurisprudences.
Au niveau des évolutions jurisprudentielles, il y a donc eu celle de la chasse à la glu qui a conduit le Conseil d’État à annuler les arrêtés sur la chasse à la glu, à la suite des motivations apportées par la Cour de justice de l’Union européenne. Concernant les animaux susceptibles de provoquer des dommages, en 2020, le tribunal administratif d’Orléans, face à des arrêtés relatifs au déterrage de blaireaux – qui ne sont d’ailleurs pas protégés mais je laisserai Mme Delattre développer ce sujet, un des arguments avancés portait sur de véritables atteintes à l’ordre public. En effet, la vénerie porterait atteinte à la dignité humaine dès lors que les chasseurs se livrent à des actes de cruauté sur des animaux doués de sensibilité.
La troisième catégorie d’animaux sauvages est celle des espèces protégées. Dans le prisme du droit de l’environnement, la seule faute d’imprudence suffit à caractériser l’élément moral du délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées.
Sur le plan politique, il y a déjà eu plusieurs tentatives pour modifier l’article 521-1 du Code pénal afin d’inclure la cruauté envers les animaux sauvages. Ces tentatives faisaient suite à diverses affaires de cruauté médiatisées. Il y a eu le cas de huit hérissons dépecés. Les auteurs de l’infraction avaient alors eu un simple rappel à la loi, alors que le hérisson est une espèce menacée d’extinction et protégée. En 2021, il y a eu le cas de ce loup pourchassé en voiture de façon plus que rapprochée avec une volonté de l’écraser, ou encore dernièrement ce loup pendu devant une mairie.
On peut citer plusieurs propositions de politiques visant à faire reconnaitre le caractère sensible de l’animal sauvage et d’étendre l’application des sanctions aux actes de cruauté perpétrés sur des animaux sauvages. En 2014, une proposition de loi accordant un statut juridique particulier à l’animal a été portée par les députées Mmes Geneviève Gaillard et Laurence Abeille. En 2016, un projet de loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages comportait des amendements en ce sens. En 2017, une question portée par la députée Mme Cazebone à l’Assemblée Nationale demandait la reconnaissance de ce caractère sensible des animaux sauvages. Le ministre d’État avait répondu : « pour ce qui est des animaux sauvages libres dans leur milieu naturel, leur protection en tant que représentants d’espèces, dont la préservation est nécessaire pour la sauvegarde de la biodiversité, est assurée sur le fondement de certains articles du code de l’environnement ». En 2021, enfin, l’amendement 113 du député Éric Diard à la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale visait précisément à apporter les modifications à l’article 521-1 du Code pénal proposées par la LFDA. Parmi les nombreuses objections à sa proposition, celle du ministre de l’Agriculture énonçait : « En visant tous les animaux, l’amendement rend passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’écraser une fourmi, d’attaquer une souris, ou de tuer un frelon. Je crains que même parmi les plus grands défenseurs de la cause animale, certains aient déjà écrasé une fourmi ou tuer un frelon. L’amendement crée à mon avis des effets de bord qui iront bien au-delà de l’objectif recherché. Je demande donc le retrait, quitte à le retravailler. » Je ne retiendrai que cette dernière partie de cette réponse. Alors oui, retravaillons ce sujet !
Le ministre de l’Agriculture rappelle régulièrement la distinction qu’il importe de faire sur le bien-être animal et la maltraitance. Le bien-être animal implique des obligations de faire. Lutter contre la maltraitance implique des obligations de ne pas faire. Le bien-être animal est défini par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Pour autant, cette définition n’a pas été reprise par la loi ou la réglementation et n’apporte donc pas de sanction. La maltraitance est un terme générique qui d’ailleurs ne fait pas l’objet de sanctions pénales dédiées. On distingue les contraventions pour les mauvais traitements des délits pour les actes de cruauté ou les sévices graves, sexuels ou l’abandon.
Pour autant, force est de constater que le véritable débat porte sur l’atteinte à la morale publique, à la sensibilité humaine. J’entends systématiquement que le droit n’est que la transcription des évolutions sociales, des avancées scientifiques, mais c’est oublier que la loi est avant tout un instrument de paix sociale. Juges, procureurs, avocats prennent le pouls, la mesure de notre état de civilisation, qu’on oppose à l’état primitif de l’homo sapiens. Politiques, législateurs, magistrats, avocats, nul ne saurait laisser exprimer l’horreur de notre nature humaine en toute impunité. Puisque l’homme se veut le maître du monde, alors soyons à la hauteur. Il ne saurait y avoir une zone de non droit pour les animaux sauvages. Il n’y a pas un mur entre le monde de la société humaine et le monde des animaux sauvages, qui ne sont pas simplement nos voisins. Il n’y a pas de mur infranchissable.
Nous n’avons pas le droit de baisser les yeux. Nous serions alors indignes d’assumer nos professions respectives. Je ne vous montrerai pas d’images sordides d’animaux torturés par des individus qui ont de surcroît la jouissance lorsqu’ils diffusent leurs actes sur des réseaux sociaux. Je laisserai votre sensibilité individuelle visualiser les scènes de ces renardeaux qui ont été extirpés de leur terrier, cernés d’individus qui exprimaient un véritable plaisir à les battre avec des barres en fer. Ne pourrait-on pas qualifier ces renardeaux d’êtres vulnérables puisque le droit pénal ne considère pas l’aspect sensible alors qu’il reconnaît l’état d’être vulnérable notamment aux enfants. Je vous laisserai donc visualiser ces scènes en fermant les yeux, parce qu’il me semble qu’il est important pour nos politiques, législateurs, magistrats, de sortir des enceintes feutrées, d’écouter les cris de ces animaux, de ne pas baisser les yeux, mais au contraire de les regarder dans les yeux. Regardez-les dans les yeux. Écoutez les cris et vous verrez la mort. Et maintenant imaginez que c’est un chien ou votre chat.
Laurence Parisot
Merci beaucoup Marie-Bénédicte, c’était très clair. Je voudrais me tourner vers vous, Loïc Obled. Vous avez un rôle difficile car il est à la fois celui d’animer l’agence principale en France en charge de protéger la biodiversité, et en même temps, vous le faites dans un cadre qui vient d’être rappelé par Muriel puis par Marie-Bénédicte, qui ne vous permet peut-être pas d’aller jusqu’où nous tous ici voudrions aller. Pouvez-vous nous rappeler comment vous fonctionnez et ce qui mériterait, selon vous, d’être précisé, clarifié ? Marie-Bénédicte vient de rappeler les paradoxes, la nécessité d’aller examiner tel ou tel texte, mais je suppose que pour vous, en pratique, dans l’application, cela doit être compliqué.
Loïc Obled[2]
Merci Laurence. Bonjour à tous. Je suis très honoré d’avoir été invité. Merci pour cette attention et merci de me laisser l’occasion de m’exprimer, et surtout de réfléchir. Parce qu’en fait, quand j’ai lu le titre de la table ronde, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir dire. L’objet social de l’OFB, c’est bien la protection de l’eau et de la biodiversité, ce n’est pas la protection de l’animal en tant qu’individu. Cependant, il y a quand même pas mal de choses à dire puisqu’effectivement l’OFB, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un établissement qui est assez neuf – il a à peine deux ans de vie. L’OFB a cinq missions. La première, c’est la connaissance de l’eau, de la faune sauvage, de la recherche et de l’acquisition de données. La deuxième mission, c’est la police de l’environnement – et là il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce qui nous intéresse. La troisième mission, Nicolas Hulot en parlait tout à l’heure, c’est la gestion d’aires protégées ou l’aide à la gestion d’aires protégées. La quatrième mission, c’est l’appui aux politiques publiques de l’État et des collectivités. Enfin, la dernière mission, qui nous intéressera, c’est la mobilisation de la société : comment arrive-t-on à mobiliser la société pour une transformation écologique et une meilleure préservation de la biodiversité et de l’eau ? Nous avons également une autre mission, plus petite par le nombre de personnes qui sont affectées, qui est l’examen du permis de chasser.
En incise, pour faire écho à tout ce qui a été dit par les deux ministres juste avant, une des caractéristiques de l’OFB, qui à mon avis est intéressante, et que c’est un établissement public de l’État avec des missions régaliennes (la police) mais où l’État n’est pas majoritaire dans le conseil d’administration. Le conseil d’administration de l’OFB comprend différentes parties : État, associations de protection de la nature, agriculteurs, chasseurs, représentants d’entreprises. C’est donc un espace de débat très intéressant et qui interroge quand on mène des missions régaliennes.
Revenons au sujet qui nous intéresse. Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des discours qui ont été dits sur le droit, effectivement entre res nullius, res propria. Il y a des choses bien cadrées pour les animaux domestiques et la faune sauvage qui a été appropriée, et des choses un peu moins claires pour ce qui concerne l’animal sauvage. L’OFB a 1500 inspecteurs de l’environnement dont la mission est de faire appliquer le droit, mais qui sont limités dans leurs compétences. Nos agents sont compétents sur le code de l’environnement et une partie du code rural. Leurs compétences couvrent notamment le braconnage et le non-respect du droit de la chasse. Ils sont compétents également pour sanctionner les atteintes aux espèces protégées. Ils sont compétents aussi pour sanctionner les atteintes à la réglementation concernant la faune sauvage captive. Par contre, ils n’ont pas de compétence à proprement parler sur la question du bien-être animal. Certains d’entre vous pourrons penser que c’est une lacune et c’est certainement vrai, mais ça nous créerait certainement, en l’état actuel de nos effectifs et des investissements qui sont les nôtres, beaucoup plus de travail par rapport à ce qu’on a aujourd’hui.
Laurence Parisot
S’il n’y a que ça, on peut pousser sur le plan budgétaire.
Loïc Obled
En tout cas, il n’y a pas de compétence en la matière. Mais il y a des éléments que vous avez évoqués qui sont intéressants. Il pourrait y avoir une règle, une loi, qu’il faudrait faire appliquer. Le tout, c’est comment on arrive à faire appliquer les choses ? Pour caractériser une infraction, il faut trois éléments. Premièrement, l’élément légal : on a des éléments légaux, sur ce que je viens de dire, qui n’existent pas, en tout cas pas pour l’individu d’espèce animale sauvage. Deuxièmement, il faut un élément matériel, et là c’est parfois compliqué. Les éléments matériels, c’est regarder que l’infraction a bien eu lieu matériellement. C’est parfois compliqué dans la nature de les constater. En tout cas, c’est plus compliqué qu’en cas de maltraitance d’un chien. Enfin, il y a l’élément moral. L’élément moral, c’est l’intention de la personne qui a commis une infraction. Il faut réussir à la prouver pour que le juge puisse poursuivre et obtenir une condamnation. Et là, c’est quelque chose qui est souvent très difficile. Si je m’en tiens aux termes du débat aujourd’hui, qui parle de maltraitance ou de cruauté, c’est bien là le nœud du problème, puisque la cruauté, c’est quoi ? C’est infliger intentionnellement des mauvais traitements. C’est un peu conceptuel mais si on a une réglementation un jour, comment on fait pour la mettre en œuvre pour qu’il y ait des procédures judiciaires, des techniques d’enquêtes qui arrivent à manifester la vérité, à montrer cet élément moral ? Désolé d’avoir été un peu technique mais ce sont les limites que certains peuvent voir à la réglementation quand on a du mal à la faire appliquer.
Pour en revenir à des choses qui sont le fruit de l’expérience, on a évoqué la chasse tout à l’heure. Il y a un droit de la chasse que l’OFB, entre autres, est en mesure de faire appliquer. Il y a ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Il y a des choses qui sont entre les deux qui ne sont pas cadrées, et qui ont fait que certains événements qui ont été mentionnés ici, ne correspondent pas à ce que les chasseurs considèrent comme l’éthique de la chasse. Donc il y aussi des chasseurs qui, par leur déontologie, vont condamner – et ça a été le cas fermement d’ailleurs sur certaines des affaires qui ont été évoquées – des choses qui ne sont certes pas répréhensibles d’un point de vue pénal, qui ne sont pas interdites, mais dont ils considèrent que ce n’est plus de la chasse. Et ça, il n’y a pas de réglementation pour le faire appliquer, mais le contrôle par les pairs est peut-être quelque chose qu’il faut pousser, en tout cas c’est ce que je pense, et que certains voudraient faire.
Laurence Parisot
Sur le contrôle par les pairs, pardon mais on ne peut pas ne pas vous poser la question : seriez-vous prêt à accepter la proposition récente de Willy Schraen que les fédérations de chasseurs vous aident dans votre travail de police ?
Loïc Obled
En fait, c’est déjà le cas. C’est-à-dire que, comme les fédérations de pêche, les fédérations de chasse peuvent employer des personnes qui sont des agents assermentés qui, dans certaines limites qu’elles ont par la loi, encadrent le droit de la chasse. Donc les acteurs qui sont concernés par la chasse s’organisent pour essayer d’avoir ce que j’appellerais un autocontrôle, et transmettent régulièrement des procédures. C’est le cas dans certaines fédérations de chasseurs. Ce n’est pas le cas dans toutes. La proposition, si je ne m’abuse, de Willy Schraen, était d’aller au-delà de la chasse. Pour en revenir juste à la chasse, dans la mesure où nos agents sont une quinzaine par département, si d’autres assurent avec nous la police de la chasse, plus il y a de personnes qui contrôlent, plus on peut espérer que la loi soit respectée. Il n’y a pas que les chasseurs, il y a aussi les agents des réserves naturelles, les agents de l’Office national des forêts (ONF), et d’autres. Juste de ce point de vue de la chasse, le contrôle par les pairs peut être quelque chose d’intéressant.
Après, parmi d’autres expériences, celles des saisies : j’étais assez ému de voir que le colloque a pour image un chardonneret qui est un oiseau magnifique, et qui est un oiseau pour lequel l’OFB s’investit beaucoup pour essayer de démanteler les trafics. Le chardonneret, pour différentes raisons, est capturé par certains dans le milieu sauvage pour être revendu. C’était des collectionneurs il y a quelques années, et puis au plus les choses vont, au plus le trafic s’organise, et au plus on essaye de démanteler ces trafics. Quand on essaie de démanteler les trafics, lors d’une perquisition par exemple, il peut arriver que l’on tombe sur des animaux qui ont été capturés. Ces animaux, il faut en faire quelque chose. On a un vrai sujet en France qui est pris à bras le corps par le gouvernement. Je sais que M. Dombreval, M. le député, vous y êtes aussi attentif. Qu’est-ce qu’on fait des animaux qu’on saisit ? Ces animaux qui sont devenus res propria de fait, dont le statut est assez incertain. Pour des raisons multiples, on peut être amené à placer ces animaux dans différentes structures. On peut être amené aussi à les relâcher dans leur milieu naturel. À chaque fois, il faut se poser les bonnes questions puisque, quand on les met dans une structure, il faut que la structure soit habilitée, qu’elle puisse prodiguer l’ensemble des soins qui sont nécessaires à la biologie de l’espèce. Et quand on les remet dans la nature, il faut aussi se dire qu’un animal qui a été imprégné, vous le savez tous, a des chances de survie qui sont largement moins importantes que les animaux qui sont présents dans la nature. Certains contrevenants ont fait que les animaux sont déjà victimes de mauvais traitements, voire de cruauté, donc qu’est-ce qu’on fait pour améliorer la condition de ces animaux en tant qu’individus ? En réfléchissant à ce que vous disiez tout à l’heure, c’est ce qui me venait à l’esprit. Après, pour essayer de le dire dans d’autres termes, il y a aussi des questions que vous vous posez : celle de l’individu par rapport à l’espèce, qui nous questionne dans nos pratiques au quotidien.
L’OFB est au service de l’État, voire le bras armé de l’État, pour certains plans nationaux d’action, pour certaines espèces. Je prends l’exemple de l’ours, ou d’autres espèces d’oiseaux par exemple. Quand on pense un programme de réintroduction d’une espèce quelque part, c’est quelque chose d’intéressant. On essaye de faire revenir une espèce dans un milieu dont elle avait disparu par exemple, ou alors de la recoloniser ailleurs, mais pour ce faire, on va prendre des individus quelque part, on va essayer de faire le plus possible attention à eux (c’est ce qu’on a fait quand on a été chercher des ours en Slovénie) et on essaye de les relâcher dans les meilleures conditions possibles. Et ce faisant, pour essayer de préserver une espèce, un noyau d’espèces, ou une population par exemple dans les Pyrénées, c’est vrai qu’on inflige des traitements à l’individu qu’on va relâcher qui ne sont pas ceux qu’il aurait peut-être souhaité dans la nature. Ça nous interroge donc aussi. On essaye de faire le bien, mais on doit prendre en compte les besoins, la biologie, la conscience, et l’essence de l’animal. C’est quelque chose qui nous interroge vraiment. D’ailleurs, en matière de connaissance, on parle d’espèces, mais quand on essaye de faire des suivis, on parle aussi d’individus. Nous, en sciences, on parle évidemment d’individus.
J’ai deux petites expériences en plus que je voulais partager avec vous, qui nous interrogent là aussi. L’une concerne, pardon de le dire comme ça, ce n’est pas très beau, l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques. Pour essayer de mieux connaître une espèce et après mieux la préserver, on est parfois amené à capturer des animaux, à les baguer, à leur poser des colliers GPS, à poser différents appareils. Ça nous permet d’avoir une connaissance améliorée de l’espèce, de penser à des mesures de gestion, de protection. Mais les individus équipés de balises GPS, de balises Argos par exemple, pour des oiseaux, eux non plus n’en auraient pas forcément voulu, si tant est qu’ils puissent le faire, alors qu’ils vivaient tranquillement dans la nature. Ce sont des questions qui se posent parce que l’ensemble des établissements scientifiques ont toujours procédé de la sorte pour essayer d’améliorer la connaissance et préserver la biodiversité. Mais se pose de plus en plus la question de savoir comment on fait. Il y a des comités d’éthique qui existent dans chacun des établissements scientifiques, et qui resserrent de plus en plus les protocoles pour éviter toute souffrance, et faire en sorte que les choses se passent au mieux pour l’espèce évidemment, mais aussi pour l’individu.
Et puis un autre sujet qui est malheureusement d’actualité, puisqu’on a des cas de grippe aviaire en ce moment dans l’Est de la France, c’est comment on arrive à gérer des individus qui peuvent être contaminés par une maladie dans la faune sauvage, et qui peuvent transmettre ces maladies. C’est quelque chose qui n’est pas simple. Un exemple tout bête est l’expérience des cygnes qui sont manifestement atteints d’influenza aviaire, qui sont dans un état de souffrance important. Comment on fait ? Qui est-ce qui met un terme à leurs souffrances s’ils ne peuvent pas être soignés ?
Voilà, après ces quelques réflexions, vous voyez que c’est un peu compliqué pour un établissement qui s’occupe de biodiversité et pas de l’animal en tant qu’individu, mais qui nous fait nous poser des questions sur chacune des missions qui sont les nôtres.
Laurence Parisot
Merci beaucoup Loïc, c’était très intéressant et éclairant sur la complexité de votre mission. Je pense qu’on y reviendra. Vous avez parlé de la chasse, alors j’ai envie vraiment qu’on continue mais sur un aspect moins joli de la chasse. Manon, vous avez été confrontée à la vénerie sous terre, et je crois que vous avez, au nom de l’ASPAS, tenté d’arrêter cette pratique par le droit. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience et peut-être de ce que vous avez fait aussi pour les blaireaux ?
Manon Delattre[3]
Bonjour. En fait, on est parti du même constat que par Mme Falaise et Mme Desvallon sur le fait qu’il y a vraiment une différence de conception entre l’animal domestique, apprivoisé ou en captivité, pour lesquels on observe une conception animaliste, dans laquelle on prend vraiment en compte l’intérêt de l’individu, et l’animal sauvage vivant à l’état de liberté. Les premiers sont protégés par le code pénal contre les sévices graves, la maltraitance, la mise à mort. Concernant l’animal sauvage libre, au contraire, il s’agit d’une conception plus environnementaliste. Dans le code de l’environnement, on prend vraiment en compte l’intérêt de l’espèce et de l’être humain. Les espèces, à l’exception de celles qui sont protégées, sont vraiment envisagées, non pas sous l’angle de leur protection, mais sous l’angle de leur mise à mort. À l’ASPAS, on essaye de limiter la souffrance des animaux sauvages libres par différents moyens, dont l’outil juridique. Là, il y a vraiment deux choses différentes qu’on a mentionnées tout au long de cette table ronde : il y a d’abord les pratiques qu’on peut considérer comme cruelles, qui sont autorisées expressément par la loi. On pense à certaines pratiques de chasse. Il faut voir où est ce qu’on met le curseur, et quelle est la définition de l’acte de cruauté. Ensuite, il y a tous les actes de cruauté en tant que tels, qui ne sont pas encadrés par la loi. Comme ils ne sont pas punis, ils sont, de fait, autorisés.
Dans le cadre des pratiques de chasse autorisées par la loi, on a notamment travaillé sur la vénerie sous terre du blaireau. Pour ceux qui ne le savent pas, même si on l’a déjà un petit peu mentionné, la vénerie sous terre est un mode de chasse qui consiste à déterrer un animal de son terrier pour le tuer. En pratique, les chasseurs, qu’on appelle les veneurs, envoient des chiens de chasse dans les terriers pour acculer l’animal sauvage qui y habite. Ensuite, au son des aboiements, ils vont repérer où est l’animal, creuser, et le déterrer à l’aide d’une grande pince. La vénerie sous terre, plus particulièrement du blaireau, est autorisée à partir de l’ouverture de la chasse (généralement en septembre) jusqu’au 15 janvier de chaque année. Le préfet peut aussi autoriser ce qu’on appelle une période complémentaire à partir du 15 mai. Le blaireau peut donc être chassé à l’extérieur de son terrier pendant toute la période de chasse classique, et en plus de ça, être chassé directement dans son habitat, dans son terrier, huit mois sur douze. À l’ASPAS, on ne peut pas, du fait du manque de loi, interdire cette pratique en se basant uniquement sur la souffrance animale. L’État a pourtant reconnu la souffrance des blaireaux lors de cette pratique en 2019. En effet, l’arrêté de 1982 qui encadre la vénerie a été modifié en 2019 pour « limiter la souffrance des animaux capturés ». C’est une modification qui interdit que les chiens mordent l’animal quand ils sont à sa poursuite dans le terrier.
Laurence Parisot
C’est une modification réglementaire ?
Manon Delattre
Oui c’est ça. C’est une modification de l’arrêté de 1982 qui interdit d’exposer l’animal à la morsure des chiens avant sa mise à mort. Or, on sait très bien que dans les faits, malheureusement, ce n’est pas envisageable car malgré cette modification des textes, les chasseurs n’ont en pratique aucune maîtrise de leurs chiens une fois qu’ils sont lâchés dans les terriers. Mais tout ça pour dire que la souffrance animale a quand même été, d’une certaine manière, reconnue par cette modification du texte, sans pour autant reconnaître le caractère sensible de l’animal, et donc sans pour autant interdire tout simplement la pratique. Et nous, à l’ASPAS, on a essayé comme on pouvait de limiter cette pratique, et de trouver, si je puis dire, des acrobaties juridiques pour essayer de voir comment on pouvait faire en se basant sur d’autres fondements que la souffrance
On a là un exemple très récent, qui se passe dans le département de la Vienne où l’ASPAS, avec une autre association qui s’appelle AVES France, a été en justice pour demander la suspension et l’annulation d’un arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse qui autorisait la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Plusieurs arguments ont été invoqués, notamment un argument de forme par rapport à la note de présentation du projet, qui était lacunaire. On a aussi invoqué un argument de conservation de l’espèce, donc plus de biodiversité, puisque c’est la seule chose qui est prise en compte dans le code de l’environnement concernant les animaux, en disant qu’en l’absence d’études dans le département, on ne connaissait pas les effectifs de blaireaux. À partir de ce moment-là, on ne pouvait pas les chasser sans étude scientifique permettant de savoir si l’espèce se portait bien ou pas. On a également contré l’argument sanitaire. En effet, le blaireau peut être porteur d’une maladie qui s’appelle la tuberculose bovine, et cet argument est souvent invoquée pour justifier le déterrage alors qu’aujourd’hui on a plusieurs d’études, dont notamment une étude de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), qui nous dit l’inutilité de tuer les blaireaux pour combattre cette maladie : au contraire, ça pourrait augmenter sa propagation. Et puis on a également utilisé un argument économique sur le fait que la préfecture ne démontrait pas la réalité des dégâts qui étaient causés par les blaireaux. On a également invoqué un dernier argument qui était le fait que les blaireautins étaient encore présents dans les terriers au 15 mai, parce que les blaireautins sont dépendants de leur mère pendant très longtemps (jusqu’à à peu près l’automne), alors que le code de l’environnement qui interdit de tuer les petits de mammifères dont la chasse est autorisée. Grâce à tous ces arguments, par une ordonnance du 27 juillet 2021, le tribunal administratif nous a donné raison et a suspendu l’arrêté en urgence. Cette année, dans le département de la Vienne, les blaireaux n’ont donc pas été chassés sous terre pendant la période complémentaire.
Laurence Parisot
Et quel est l’argument ou les arguments qui ont fait mouche, si je puis dire ?
Manon Delattre
Ce qui est assez intéressant, c’est que la juge a retenu tous nos arguments. Il faut savoir qu’on a obtenu seulement la suspension. On est encore en attente d’un jugement sur le fond. Là, c’était vraiment en urgence. Pour l’instant, on n’a pas encore le résultat. On va voir si le juge du fond suit le juge des référés qui nous a délivré cette ordonnance. En tout cas, c’est vraiment un exemple qui montre les difficultés auxquelles est confrontée l’ASPAS. Comme on ne peut pas invoquer la souffrance, comment peut-on faire ? Nous tentons d’agir par des moyens détournés et des astuces juridiques pour essayer de mieux prendre en compte les animaux sauvages, et de ne pas se limiter aux seules espèces protégées.
Et puis il y a aussi tout ce qui est acte de cruauté. C’est un peu ce que disait Mme Falaise tout à l’heure, concernant le blaireau – cette espèce méconnue mais de laquelle on parle beaucoup pendant ce colloque – qui a été torturé par des jeunes en Isère. Je vais reprendre l’argumentaire de M. Obled : il y avait, selon nous, un élément légal. On a essayé de faire valoir que l’animal était captif. C’est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais notre raisonnement était le suivant : comme les actes de cruauté ne peuvent être reconnus qu’à l’animal domestique ou à l’animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, notre seule solution pour faire reconnaitre un acte de cruauté sur un animal sauvage est de démontrer que l’animal est captif. Dans notre argumentation, nous avons donc estimé qu’à partir du moment où des mauvais traitements ont pu être infligé à un animal, il était forcément entre les mains de l’homme et donc automatiquement en captivité. Notre argument n’a pas été retenu. On sait très bien que la définition qu’on donne de la captivité en droit est différente de la définition de la captivité dans les faits. Cela fait également penser à l’exemple de la chasse en enclos dans le cadre de laquelle les animaux sont, de fait, prisonniers et ne peuvent pas s’échapper, mais sont considérés en droit comme des animaux libres. On peut donc légalement leur infliger toutes sortes de tortures.
Pour en revenir à ce blaireau, on avait donc caractérisé cet élément légal. On avait également l’élément matériel puisqu’il y avait des vidéos qui avaient été diffusées par ces jeunes sur les réseaux sociaux. Et puis on avait l’élément moral car évidemment il y avait l’intention : sur les vidéos, on voit les jeunes sauter sur le blaireau vivant et s’amuser avec de manière tout à fait intentionnelle. Donc vraiment, il y avait cette intention qui était là et qui ne pouvait pas être remise en question. Et pourtant, notre interprétation n’a pas été reconnue puisque le procureur nous a répondu, je cite : « les actes de cruauté ne pouvant être retenus que pour un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ce qui n’est pas le cas du blaireau ». On a donc manifestement considéré que le blaireau ne pouvait pas être captif en tant qu’animal.
Laurence Parisot
Donc c’est à partir de l’espèce que le procureur a considéré que ça ne pouvait pas s’appliquer ?
Manon Delattre
Voilà. Et cette affaire a été classée sans suite. On en a parlé tout à l’heure, la LFDA a également porté plainte sur cette affaire. Nous, on est en train de voir avec notre avocat ce qu’on peut faire pour essayer d’aller un peu plus loin et pour ne pas laisser les choses en l’état. Quoi qu’il en soit, notre plainte a été classée sans suite par le procureur.
Laurence Parisot
Merci beaucoup, Manon, pour ce témoignage très important et porteur d’espoir aussi. Ça nous permet de faire un lien avec Loïc parce qu’on voit bien que l’on va avoir besoin du législateur. Même si par quelques habiletés juridiques, on arrive parfois à limiter les dégâts, il est évident qu’il faut faire plus, et ce sera bien pour l’ASPAS mais aussi je pense pour le travail de l’OFB.
Loïc Dombreval[4]
Avant tout, merci Laurence et merci à la LFDA, merci à Louis Schweitzer pour cette invitation. J’ai toujours tendance, à chaque fois qu’on m’interroge sur la LFDA – un nom un peu compliqué à prononcer, à dire que c’est vraiment une fondation qui, par la rigueur de ces démonstrations scientifiques et juridiques, fait vraiment honneur à la protection animale en France. Donc merci, vraiment, pour la qualité du travail que vous faites. Je remercie aussi Descartes car je vois qu’on parle sous son regard. Il est là Descartes, je pense que personne ici ne le remercie…
Laurence Parisot
C’est pour le narguer que chaque année on organise notre colloque ici.
Loïc Dombreval
On va faire en sorte qu’il ne nous écoute pas…
Je voudrais d’abord commencer en disant, oui, on a peut-être besoin de la loi et du législateur, mais vous savez, la législation, elle est parfois complètement absurde, elle est parfois complètement schizophrène. Je vais vous donner quelques exemples en essayant de ne pas plomber l’ambiance. Plomber, c’est le cas de le dire. En 1850, Grammont, pour la première fois à l’Assemblée nationale, défend une loi pour interdire les actes de maltraitance en public. Il faut attendre 109 ans le décret Michelet en 1959, qui étend la loi Grammont pour dire « pas uniquement en public, on va aussi faire ça en privé ». Que penser de la corrida qui est un acte de cruauté dans l’immense majorité des départements français et qui ne l’est pas dans neuf départements français ? Je ne sais pas si vous voulez toujours avoir affaire au législateur pour travailler sur les questions qui ont trait aux sanctions des atteintes à la faune sauvage… Comment voulez-vous que les gens s’y repèrent, s’ils ne comprennent quelque chose à la loi et même parfois au travail qui est fait par les députés ? Si j’organise une corrida en Bretagne, je vais peut-être juste prendre deux ans et 30 000 euros d’amende [ndlr : 3 ans et 45 000 euros d’amende depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539] alors que je serai félicité et applaudi si je suis 600 kilomètres plus bas. C’est quand même compliqué à comprendre. Parenthèse fermée.
Si on se préoccupe de la question de la faune sauvage en liberté, alors là, c’est presque le pompon. C’est au moins l’équivalent de ce qui se passe en matière de corrida. La faune sauvage, si elle est captive, vous rentrez effectivement dans un cas particulier avec le renforcement prochain des peines, et je parle sous contrôle de mon collègue Dimitri Houbron, qui a aussi été une pièce absolument maîtresse à l’Assemblée nationale pour faire avancer les questions de condition animale. Là, on va renforcer les sanctions pénales, et on va effectivement passer de 2 ans et 30 000 euros, à 3 ans et 45000 euros, voire 5 ans et 75 000 euros, en fonction des conditions dans lesquelles seront réalisés ces actes de maltraitance ou de cruauté, selon qu’ils auront entraîné la mort ou pas de l’animal.
Ensuite, on rentre dans la faune sauvage. Cette fois-ci libre mais non protégée. Ça a été évoqué, c’est un res nullius : vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Vous pouvez couper un animal en deux, un renard en deux, un blaireau en deux, devant femmes et enfants ou devant mari et enfant – en général c’est plutôt des actes commis par les hommes, même quasiment uniquement, il ne se passe rien. Par contre, vous coupez le chien de votre voisin, là vous êtes soumis à ces sanctions pénales qui, je le répète, vont être renforcées tout à l’heure[5]. Et puis, si cette faune sauvage est libre mais protégée, alors vous prenez 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende quand même. Cette sanction pénale existe, elle est extrêmement dissuasive. Sauf que, je ne sais pas si l’excellent Allain Bourgain-Dubourg vous l’a dit, mais il y a eu récemment un communiqué de presse qui indiquait que la LPO n’arrêtait pas de voir en ce moment – je parle aussi sous le regard de mon ancien professeur de Maison-Alfort, le Pr Jean-François Courreau qui a souvent affaire à ces questions – des éperviers, faucons, aigles royaux… plombés. Les 3 ans et 150 000 euros, ils sont où ? Parce que c’est extrêmement compliqué de sanctionner des atteintes à la faune sauvage en liberté. La faune sauvage en liberté à laquelle on a porté atteinte ne va pas aller faire une patte courante à la gendarmerie du coin ! Enfin une main courante mais voilà… C’était une blague mais apparemment ça n’a pas marché…
On voit bien que les sanctions pénales, même si elles sont extrêmement dissuasives sur les espèces protégées libres, sauvages, ça ne marche pas. Et on continue à voir ces actes de maltraitance, en l’occurrence ce qui a été évoqué et vu par la LPO, par l’ensemble des centres de soins pour la faune sauvage. La sanction, je vous en parlerai parce que c’est d’après la proposition de loi qui va être votée tout à l’heure. Mais il me semble que la prévention et l’éducation sont des éléments absolument indispensables, essentiels, notamment quand cette prévention et cette éducation s’exercent sur des zones sous tension comme les Pyrénées avec l’ours, le Jura et les Vosges avec le lynx, et les Alpes-Maritimes, et d’autres départements avec le loup.
Vous avez vu également, et on ne sait pas ce que ça va donner, qu’il y a eu une pétition qui a recueilli plus de cent mille signatures faites au Sénat. Cela va entraîner une mission de contrôle, soit une sorte de commission d’enquête dans laquelle 17 sénateurs vont être autour de la table pour travailler sur ces questions. Il y aura beaucoup de sénateurs chasseurs, j’imagine, mais il y aura aussi des sénateurs qui je pense ne se feront pas avoir. Cette commission, c’est assez nouveau, et moi j’aime bien ces types des pétitions. Au Sénat, c’est bien, il ne faut que 100 000 signatures, alors qu’à l’Assemblée, il en faut 500 000. C’est cinq fois plus, mais cette possibilité est ouverte.
Un autre point – excusez-moi, c’est un petit peu décousu tout ça – porte sur ce qu’on appelait les nuisibles. Puisque les nuisibles, c’est vilain, on les appelle les ESOD maintenant : les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces animaux sont détruits sans qu’il n’y ait jamais la moindre évaluation de l’impact de cette destruction. Les arrêtés préfectoraux sont pris sans évaluation de l’impact des destructions. Aucune méthode alternative à la méthode létale est proposée par, encore une fois, ces arrêtés préfectoraux. Jamais d’évaluation d’efficacité de ces mesures létales. Là aussi, il y a matière à mieux réglementer, peut-être à légiférer, je ne sais pas, en tout cas à réglementer, pour faire en sorte qu’avant d’engager des processus de destruction, il y ait des évaluations qui soient faites avant et après pour savoir si elles sont efficaces.
Un point qui me paraît tout à fait surprenant dans un pays où on a des droits mais aussi des devoirs, c’est la question du loup. Aujourd’hui, contrairement au lynx d’ailleurs, pour recevoir des indemnisations, il n’y a pas d’obligation d’utiliser les moyens de protection passive à disposition des bergers pour se protéger du loup. C’est aussi une réalité, et je pense qu’il y a là également une façon peut-être d’avancer sur ce point-là.
Je vais continuer dans ma litanie. Vous avez vu que sur les chasses traditionnelles, l’exemple de la glu est un exemple récent, avec une chasse qui est objectivement considérée non sélective, donc avec des atteintes à la biodiversité. On a des difficultés énormes, vous l’avez vu, à mettre en œuvre l’interdiction de la glu. D’ailleurs, elle n’est toujours pas interdite par la loi. C’est un quota zéro qui a été proposé par Barbara Pompili et par le président de la République sur ces chasses à la glu. Vous avez vu également que le juge des référés du Conseil d’État du 25 octobre 2021 revient sur une décision d’arrêté ministériel pour faire en sorte que les chasses traditionnelles, de façon générale, soient de nouveau interdites. Mais le jugement sur le fond n’est pas encore fait. Des chasses non sélectives susceptibles d’atteindre des espèces protégées ont encore beaucoup de mal à être interdites dans notre pays. C’est aussi des points qu’il faut quand même évoquer.
Quand j’en reviens à la question de l’éducation et de la prévention, je pense vraiment que la sanction de la maltraitance, de la cruauté envers la faune sauvage, c’est une sanction pour mieux protéger les espèces. C’est une sanction pour faire en sorte que ces espèces ne disparaissent pas, pour maintenir une biodiversité qui était exceptionnelle en France. Je pense qu’il y a là, et ça a été dit à plusieurs reprises, plus que des sanctions, un travail immense, colossal à faire sur la question de la fragmentation des milieux naturels, sur la question de l’artificialisation de nos sols, sur la question des diverses pollutions d’origine humaine, que ce soit de l’air, du sol, de l’eau, qui sont des atteintes absolument terribles à la biodiversité et en particulier à la faune sauvage, et encore plus particulièrement à la faune sauvage protégée. Il y a un travail absolument extraordinaire à faire, et qui a commencé dans le cadre du projet de loi pour la résilience, qui a été voté à l’Assemblée nationale. On a souhaité atteindre un objectif plus important de protection forte de notre territoire. À peine 0,8% du territoire aujourd’hui est un territoire dans lequel on ne peut pas chasser par exemple. Parce que même dans des espaces de protection forte, en France, on peut chasser, on peut déforester. C’est ça la réalité. Là aussi, de façon réglementaire, de façon législative, on doit pouvoir avancer sur ces questions qui sont probablement à plus ou moins long terme, mais les meilleurs moyens d’éviter des atteintes à la biodiversité et à la faune sauvage.
Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c’est que l’amendement Glavany porté par Jean Glavany en 2015, a placé l’animal, « en lévitation juridique », comme le dit Jean-Pierre Marguénaud – l’excellent juriste, pape du droit animal en France. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Alors quoi ? C’est un être vivant doué de sensibilité ou c’est un bien ? On ne sait pas. Et évidemment – et je sais que Dimitri Houbron conclura sa prise de parole tout à l’heure en discussion générale à l’Assemblée nationale sur ce sujet, et je le ferai également – l’étape suivante, sur la loi qu’on va voter, c’est la réflexion sur le statut juridique de l’animal. Ce n’est pas un objet, ce n’est pas une personne, ce n’est pas un citoyen, c’est un animal. C’est une personnalité animale. C’est une personnalité non-humaine, en tout cas, ce n’est pas un objet. Là-dessus, je crois qu’il y a un gros travail à faire. Un travail passionnant, un travail compliqué, un travail qui sera long.
Et puis bien sûr, de façon plus anecdotique parce qu’on y viendra inévitablement, et c’est aussi comme ça que je finirai ma discussion générale, on en viendra probablement, dans les années qui viennent, dans la prochaine législature puisqu’elle s’achève bientôt, à parler sereinement dans l’hémicycle, puisque ce n’est pas le cas aujourd’hui, de la question de la chasse en enclos. Il faut voir l’excellent reportage fait par Hugo Clément sur cette question. Il y a une proposition de loi en cours par un député de Sologne, François Cormier-Bouligeon, qui fait l’unanimité, même auprès du monde de la chasse, pour interdire la chasse en enclos. Je l’ai évidemment cosignée, Dimitri l’a cosignée, on est très nombreux à l’avoir cosignée.
Sur la question de la chasse à courre, on en parlait tout à l’heure avec Laurence, je pense que le sujet est mûr. On va réussir à mettre fin à la chasse à courre, il faudra une proposition de loi pour le faire. Et puis également l’élevage des gibiers exclusivement élevés pour la chasse, ce qui est une absurdité. La boucle est bouclée depuis le début de mon intervention, et qui doit évidemment s’achever dans les délais les plus brefs. Ces sujets ne sont pas dans la proposition de loi que l’on a défendue avec Dimitri Houbron et avec Laëtitia Romeiro Dias. Ils le seront de façon absolument certaine dans la prochaine législature, et au plus tard dans celle d’après. Merci beaucoup.
[1] Avocate au Barreau de Paris, elle a créé la commission ouverte sur le droit de l’animal du Barreau de Paris en juin 2018. Retour
[2] Directeur général délégué « police, connaissance et expertise » de l’Office français de la biodiversité. Retour
[3] Juriste à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). Retour
[4] Député, président du groupe d’étude parlementaire « condition animale ». Retour
[5] Le colloque s’est déroulé le jour de l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Retour
Lire les autres interventions :
- Introduction par Louis Schweitzer
- Le respect de la faune sauvage : un impératif pour la biodiversité, un enjeu pour l’humanité par Gilles Boeuf
- Table ronde : Comprendre les menaces par Hélène Soubelet, Jean-Marc Landry et Laurence Parisot
- Table ronde : Se réconcilier avec la faune sauvage par Maud Lelièvre, Sabrina Krief et Antoine Frérot et Humberto Delgado Rosa
- Le rôle des associations et de l’opinion dans la protection de la faune par Allain Bougrain-Dubourg
- Message de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Barbara Pompili
- L’engagement pour préserver les animaux sauvages en liberté par Nicolas Hulot
- Faune sauvage, de l’espèce à l’individu : un besoin de cohérence juridique par Muriel Falaise
- Échanges avec le public et Hugo Clément