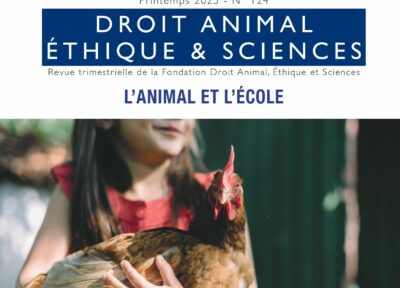Table ronde sur les solutions possibles afin de se réconcilier avec la faune sauvage dans le cadre du colloque « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté » organisé par la LFDA le 16 novembre 2021 au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Par Louis Schweitzer, président de la LFDA, Maud Lelièvre, Présidente du comité français de l’UICN et membre du conseil international de l’UICN, Sabrina Krief, Vétérinaire et primatologue et Antoine Frérot, PDG de Veolia. Nous finirons par une intervention de Humberto Delgado Rosa, Directeur pour le Capital Naturel à la Direction Générale Environnement de la Commission européenne.

© Gabriel Legros
Télécharger les actes du colloque au format PDF.
Louis Schweitzer
Bienvenue à notre seconde table ronde de la matinée. Je souhaite la bienvenue à nos intervenants. Nous allons essayer de parler des solutions aux problèmes qui ont été évoqués lors de la première table ronde. La philosophie de départ, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c’est qu’il ne suffit pas de se lamenter et d’espérer que d’autres que nous résoudrons les problèmes. Si nous n’y travaillons pas, il ne se passera rien. Pour traiter de ces solutions, nous avons quatre intervenants que nous pensons extrêmement qualifiés.
En premier lieu, nous écouterons Maud Lelièvre, qui est une juriste et une élue, mais qui est aussi la représentante pour l’Europe de l’UICN – que Gilles Bœuf a évoqué dans son propos introductif. Elle nous présentera la problématique au niveau global de la lutte pour se réconcilier avec la faune sauvage. Ensuite nous écouterons Sabrina Krief, vétérinaire de formation, spécialiste des primates, avec lesquels je crois qu’elle a vécu, et qui nous expliquera, sur cette espèce encore plus proche de l’homme que les loups mais que moins d’entre nous ont eu l’occasion de voir à l’état sauvage, le problème et les approches qui permettent de préserver ces espèces. Et puis le troisième intervenant sera Antoine Frérot, président directeur général de Veolia, une entreprise dont le projet, le sujet, la raison d’être est l’environnement, et qui nous parlera de comment les entreprises peuvent contribuer. Dans une économie ouverte comme la nôtre, si les entreprises ne jouent pas le jeu, rien ne réussit. Et enfin M. Humberto Delgado Rosa, directeur pour le capital naturel à la Direction générale environnement de la Commission européenne, nous parlera des ambitions et des projets européens pour se réconcilier avec la faune sauvage et agir. On le sait bien pour les animaux sauvages : les frontières, là aussi le loup l’illustre, n’existent pas.
Maud Lelièvre[1]
Merci M. Schweitzer, avant tout pour votre engagement sans faille dont le monde a besoin. Et puis merci à la fondation Droit Animal, Éthique et Sciences pour avoir réuni aujourd’hui ce beau colloque pour replacer l’animal au cœur de notre vision du monde.
Alors quel est notre rapport au monde animal ? Les animaux ont-ils des droits ? Vaste sujet… Nous sommes aujourd’hui dans une situation où l’être humain a bouleversé la planète à son profit : il a multiplié les espèces dites utiles, la biomasse aujourd’hui des animaux domestiques est supérieure à celle des animaux sauvages, qui ne cesse de diminuer. Les polémiques sont aujourd’hui présentes dans l’opinion publique. On a parlé du loup, mais on pourrait également parler de l’ours, des abattoirs, de la consommation de viande, de l’utilisation du cuir, des feux d’Amazonie, des mers aujourd’hui où le plastique a remplacé la vie, des zoonoses… Bref, tous ces sujets illustrent les limites de notre rapport aux animaux et à la vie. L’humain peut-il se réconcilier avec le vivant et la biodiversité ? C’est un sujet qui est ancien, et pour commencer j’aimerais vous relire une lettre d’invitation que vous allez trouver terriblement contemporaine : « La nature, dans ses trois règnes, est de toute part menacée par les progrès de l’industrie. L’activité de l’homme gagne des régions jusqu’ici inaccessibles à ces entreprises. Son caprice ou son utilitarisme imprévoyant mettent en péril l’existence d’un grand nombre d’espèces animales ou végétales. Tous les amis, tous les défenseurs de la nature, doivent se regrouper pour élever la voix et exercer une action protectrice qui sauvegarde pour l’avenir notre patrimoine naturel et les espèces sauvages. » Cette lettre est la lettre d’invitation au premier congrès international pour la protection de la nature qui s’est tenu à Paris en 1922. On peut dire qu’elle est toujours d’actualité.
Alors M. le Président, vous m’avez fait l’honneur de m’inviter aujourd’hui ici en tant que présidente de l’UICN. L’Union internationale de conservation de la nature, qui est une vieille organisation maintenant, a été créée il y a 73 ans en France à Fontainebleau. La France, à l’époque, avait été choisie parce que c’était le pays dans lequel il y avait la plus ancienne protection des paysages et des écosystèmes. On ne l’appelait pas comme cela à l’époque, puisque c’était en 1861 qu’avait été créée à Fontainebleau la préservation de la forêt pour permettre à l’époque aux peintres de Barbizon de continuer à peindre l’exceptionnel forêt qu’ils avaient sous les yeux. C’est la raison pour laquelle l’UICN a trouvé son siège en France. L’UICN a changé depuis. Elle est devenue une grande organisation internationale qui regroupe 1400 grandes ONG, Gilles Boeuf l’a rappelé tout à l’heure dans son propos introductif, 120 États – qui sont parties, comme dans les conférences des parties (COP) –, et qui est présente dans l’ensemble des pays du monde.
Cette organisation mondiale tient tous les quatre ans un congrès. Il s’est tenu cette année en France à Marseille au début du mois de septembre. Lors de ces congrès, l’UICN publie ce qu’on appelle des motions, des recommandations, qui sont des grandes orientations politiques sur les différents enjeux de la biodiversité. Je ne vais pas les citer, si ce n’est peut-être deux d’entre-elles qui sont en lien avec notre colloque ce matin : d’abord la motion 47, qui a pris des orientations fortes pour traiter de la criminalité organisée, puis établir des normes juridiques aux plans internationaux et nationaux ; et puis la motion 50, pour mettre en place des mesures internationales afin de lutter contre les trafics en ligne, et notamment les trafics issus d’espèces animales et végétales.
On décrit souvent ces réunions internationales en disant : « Ça ne sert à rien. Les gens se réunissent, discutent et prennent des positions, mais ça ne sert à rien. » Or, au sein de l’UICN, on a cette chance d’avoir une organisation internationale qui n’existe dans aucune autre organisation internationale, qui est hybride entre les États qui s’engagent et les ONG qui portent sur les terrains des programmes locaux, mais qui sert aussi de vigie, de défenseur et de vigilant. Cette organisation allie aussi le monde économique. Vous l’avez rappelé, c’est important, car on ne fait pas de transitions majeures si on ne change pas le système économique mondial.
Ce congrès a permis de rappeler les pressions nombreuses qui s’exercent sur la biodiversité : le changement d’utilisation des terres avant tout, la déforestation, l’artificialisation, la surexploitation des espèces, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Il a également mis dans ces sujets importants la question du dérèglement climatique, qui est un sujet d’actualité. Je vais l’illustrer par un exemple. On publie, au sein de l’UICN, ce qu’on appelle des listes rouges, soit des listes d’espèces en voie de disparition –j’y reviendrai un peu plus longuement tout à l’heure. Lors du congrès, on a mis en évidence la disparition du dragon de Komodo. Vous devez voir à peu près ce à quoi ressemble un dragon de Komodo. C’est la plus grande espèce de lézard au monde, et cette espèce est protégée. Elle vit dans le parc de Komodo, dans un site protégé. Le réchauffement climatique menace sa survie, et cette espèce emblématique en précèdera bien d’autres si nous n’arrêtons pas l’augmentation des températures.
J’aimerais revenir un instant sur la COP de Paris, la COP21, dont on oublie très souvent qu’elle a donné des grandes orientations en matière de climat, grâce notamment aux négociations à l’époque du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, mais qui pour la première fois aussi intégrait la question de la nature, de la biodiversité et des écosystèmes. Et cela, on le doit particulièrement à la France. C’était la première fois où, finalement, on a fait entrer la biodiversité dans les négociations climatiques.
C’est un lien qui a été réaffirmé au moment du pacte de Glasgow dans la COP qui vient de se terminer, qui est décriée pour sa faiblesse, mais qui a une nouvelle fois avancé un peu plus sur le champ de la biodiversité où l’interconnexion des crises est reconnue, où la nécessité de traiter les deux crises de façon conjointe a été mise en avant. Il y a été rappelé qu’il ne faut pas trouver de mauvaises ou de fausses bonnes solutions, à commencer par la replantation massive, dite de compensation, un peu partout, un peu n’importe comment, sur des écosystèmes protégés, et souvent au détriment des populations et de l’agriculture vivrière. Les débats ont aussi rappelé qu’on ne peut pas miser sur la technologie pour nous sauver de tout, et peut-être, comme prévenait Darwin, « c’est lorsque l’on se croit supérieur qu’on se met en danger ». C’est souvent le cas aujourd’hui lorsqu’on parle de biodiversité. Alors réconcilier pour comprendre, c’est aussi savoir préserver.
Nous avons un indicateur très fort au sein de l’UICN, qui s’appelle depuis les années 1960 « les listes rouges » – vous devez en entendre parler de façon régulière dans la presse – qui dressent un tableau préoccupant, souvent, de l’état de santé de la biodiversité dans tous les écosystèmes, sur tous les territoires, dans toutes les espèces. On ne peut malheureusement pas encore tout catégoriser, mais cela permet à la fois de connaître et de pouvoir aussi mesurer les bénéfices de la conservation.
J’aime bien, quand on parle d’espèces et de monde sauvage, essayer de trouver des bonnes nouvelles, parce que si on se dit que l’espoir est vain, alors on n’agit plus. Parmi les bonnes nouvelles qui montrent qu’il est nécessaire de se battre, je citerai la loutre d’Europe pour qui un certain nombre de campagnes ont été particulièrement efficaces. Elle était dans une situation très précaire il y a quelques années et a désormais recolonisé de vastes parties de son territoire dans les régions françaises, pour prendre un exemple français. Autre action : celle sur la protection des zones humides, qui a amélioré la situation de plusieurs échassiers – je vois le président de la LPO au premier rang – et notamment la spatule blanche. On pourrait aussi citer le bouquetin des Alpes qui avait quasiment disparu en France, et qui, grâce notamment à la création de parcs nationaux alpins, repeuple aujourd’hui plusieurs départements. Et puis enfin, grâce aux programmes de réintroduction, le vautour moine qui niche à nouveau dans les Grands Causses et qui avait disparu en France depuis à peu près un siècle. Ces réussites remarquables, elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont avant tout le fruit du travail d’expertises, d’identification, et surtout le travail des grandes organisations : des ONG, des associations environnementales, dont la LPO, qui soutiennent et qui travaillent sur le terrain avec des moyens financiers et humains adaptés pour faire en sorte que ces espèces reviennent ou ne disparaissent pas totalement.
Se réconcilier avec la faune sauvage, c’est aussi choisir de préserver les écosystèmes, la planète. Ni la faune sauvage, ni nous d’ailleurs, êtres humains, ne pourront continuer à vivre sur une planète de plus en plus dévastée. On peut chercher son salut dans les missions sur Mars, ou aujourd’hui dans l’aspect émergeant des vies parallèles et numériques, mais il faut avant tout préserver le territoire. L’objectif, on y vient aujourd’hui, de 30 % d’aires protégées à horizon 2030, avec 10 % de protection en zone forte, est une demande absolument incontournable. C’est une première étape parce que, demain, c’est toute la planète qu’il faudra protéger pour lui rendre sa fonction maternelle.
Sur préservation des écosystèmes, je vais vous livrer, peut-être en avant-première, un sujet qui va être émergeant dans les prochaines années : celui du statut vert des espèces. C’est un nouveau standard mondial qui vient d’être finalisé par l’Union internationale de conservation de la nature, et son objectif est de mesurer les succès de conservation et le potentiel de rétablissement des espèces sauvages. C’est un outil qui complète les listes rouges. Il ne suffit pas d’avoir en gros « le thermomètre », il faut aussi pouvoir « baisser la température ». Il comporte cinq objectifs convergeant dans ce cadre international :
1° d’abord fournir un cadre pour mesurer le rétablissement des espèces,
2° ensuite reconnaître les réalisations en matière de conservation pour pouvoir aussi les dupliquer,
3° mettre en évidence les espèces dont le statut dépend de la poursuite des actions de conservation,
4° prévoir l’impact attendu des actions de conservation planifiées,
5° et enfin relever, et c’est absolument essentiel, les niveaux d’ambition pour un rétablissement des espèces à long terme.
En résumé, ce statut vert de demain rendra visible ce travail aujourd’hui invisible de protection des espèces qui est mené par les acteurs de la conservation. C’est un outil essentiel et absolument complémentaire des listes rouges. Bien évidemment, l’Union internationale de conservation de la nature en France, le comité français, le déploiera à partir de 2022, et en fera une application nationale.
Nous n’avons pas d’autre choix aujourd’hui que de nous réconcilier avec la nature. On a assez détruit. On a besoin de préserver pour nous-même, pour les générations futures, et pour la planète sur laquelle on est. Je vais conclure par cette citation qui est celle de Ian Macmillan, un ornithologue américain, qui explique pourquoi il faut préserver : « Il faut sauver les condors non seulement parce que nous avons besoin des condors, mais parce que nous avons besoin de développer les qualités humaines nécessaires pour les sauver. Car c’est de ces qualités humaines dont nous aurons besoin demain pour nous sauver nous-même. »
Sabrina Krief[2]
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup M. Schweitzer de me laisser l’opportunité de vous parler des grands singes et tout particulièrement des chimpanzés. Je vais, au cours de cette présentation, reparler de nombreux points qui ont déjà été abordés précédemment. Tout d’abord, celui de la table ronde précédente : les chimpanzés sont des espèces emblématiques d’un écosystème menacé, la forêt tropicale, mais également riche d’une extraordinaire biodiversité. Notre souhait est « d’utiliser » cette espèce charismatique pour en protéger des milliers d’autres qui partagent cet habitat, préservant ainsi les liens entre elles et donc leurs fonctionnalités. On fera le lien entre les interventions de ce matin qui portent sur la biodiversité, et celles de cet après-midi qui portent sur l’individu, sur l’animal, et j’aborderai également des aspects plus concrets, puisque je voudrais évoquer notre rôle dans la préservation des écosystèmes et des espèces en tant que consommateurs.
Le chimpanzé est une espèce parmi plus de 500 espèces de primates, un ordre auquel nous appartenons. Cette abondance d’espèces illustre très bien à quel point un écosystème peut abriter une diversité d’espèces, de populations et d’individus qui sont proches phylogénétiquement, puisque quatre-vingt-dix pour cent de ces 500 espèces vivent en forêts tropicales. Leur répartition de part et d’autre de l’Équateur montre qu’elles sont capables de cohabiter, de coexister ; quelquefois une dizaine ou une quinzaine d’espèces vivent en bonne harmonie dans un même espace forestier. Cela veut dire que nous, humains, qui faisons partie de ces primates, devrions pouvoir aussi cohabiter avec nos plus proches parents sans que des compétitions pour l’espace et la nourriture se soldent par l’anéantissement des autres espèces au profit d’une seule… la nôtre ! Cependant, les chiffres actuels sont vraiment criants et alarmants puisque parmi ces 500 espèces, plus de la moitié d’entre-elles sont menacées. Quand on parle en termes de population, c’est encore pire : ce sont les trois quarts des populations qui sont menacées. Comme ces primates habitent un écosystème extrêmement riche en biodiversité animale comme végétale, ainsi que l’a souligné Gilles Bœuf, leur disparition est un très mauvais signe pour un écosystème qui est également un écosystème clé en termes de changements climatiques.
Pour revenir sur l’exemple que donnait Maud Lelièvre, le fait que nos enjeux climatiques et nos enjeux de biodiversité sont liés et doivent mobiliser nos forces, ces forêts tropicales incarnent la direction vers laquelle on devrait aller : en les protégeant, on préserve à la fois la très grande biodiversité qui y vit et on modère les changements climatiques. Au travers des forêts et des chimpanzés, on part d’aspects globaux parfois peu évocateurs pour le grand public qui vit loin de ces écosystèmes pour aller vers des choses plus concrètes, plus parlantes, impliquant des actions locales. S’engager dans la préservation d’une espèce-clé, emblématique d’un écosystème vital pour la planète et agir avec et pour les communautés locales par des gestes du quotidien, comme celui de boire du thé, est un moyen d’agir : c’est ce que nous allons proposer maintenant.
Ainsi, si on resserre un peu notre spectre et qu’on utilise cet indicateur qu’est la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, parmi ces 500 espèces de primates, on trouve les sept espèces de grands singes, encore plus proches de nous et toutes menacées : deux espèces de gorilles, deux espèces de chimpanzés, trois espèces d’orangs outans, soit en danger, soit en danger critique d’extinction. Elles nous rappellent à quel point nos destins sont liés. Leur disparition imminente souligne l’urgence de lutter contre la déforestation, la principale menace qui pèse sur leur survie, et ainsi contre le changement climatique. Pour proposer des solutions, il faut comprendre les causes, les connaître, et ensuite les partager.
Il est donc désormais clair que la principale cause de disparition des primates est la fragmentation de leurs habitats : des plus petits, qui vont du microcèbe de quelques dizaines de grammes, au plus gros, le gorille avec ses plus de 200 kg pour les mâles, tous sont menacés par la disparition des forêts. Elle est principalement due aujourd’hui au développement de l’agriculture intensive : 76 % des espèces de primates sont concernées par cette menace. Par l’exploitation forestière directe bien sûr, mais également par les exploitations minières qui peuvent y être associées. Ces pertes d’habitat, ces ouvertures de brèches dans cette forêt tropicale, sont aussi associées à une autre menace qui se combine et l’aggrave : celle de la chasse. On devrait dire de braconnage, puisque la plupart des espèces sont protégées et le plus souvent la chasse est réglementée et interdite. Mais également l’élevage, puisque pour la production de soja – et ça a déjà été évoqué – ainsi que de thé, de café, de cacao, d’huile de palme ou de canne à sucre, il faut prendre de l’espace sur les forêts tropicales.
Ce sont donc non seulement des espèces, mais aussi des populations qui sont menacées et qui se retrouvent isolées géographiquement, avec des dérives génétiques qui peuvent se produire. D’ici peut-être une trentaine d’années, certaines de ces espèces, dont les chimpanzés, ne seront plus capables de vivre sur notre planète, car le nombre critique minimum d’individus pour pouvoir faire perdurer ces populations sera trop faible. Il restera des chimpanzés dans des fragments de forêts tropicales, mais les populations ne seront plus viables. Nous ne pouvons plus ignorer aujourd’hui le lien entre espèces et individus : avec ces populations qui disparaissent, ce sont aussi des cultures qui disparaissent. Les chimpanzés ne sont pas des individus interchangeables. Chaque groupe social a une culture qui lui est propre et qui est différente du groupe voisin : certaines sont capables d’utiliser des outils en pierre, d’autres des outils en bois. Certaines font la danse de la pluie et d’autres non. Chaque groupe utilise des plantes différentes pour se soigner. Ces comportements ne sont pas universels. Protéger des populations et des individus, c’est protéger non seulement un patrimoine naturel mais également le patrimoine culturel de cette espèce et en termes d’éthique et de droit animal, c’est un point que la science nous apprend aujourd’hui et qu’il faut prendre en compte.
Enfin, ça nous met aussi face à une réalité : cette agriculture intensive qui se développe aux dépens des forêts tropicales et les rapproche toujours plus expose la faune sauvage – non seulement les grands singes, mais aussi les insectes, et donc nos polinisateurs –, aux maladies zoonotiques mais aussi à la pollution par les pesticides.
Maintenant qu’on a fait le constat de ces disparitions, maintenant qu’on en connaît les causes, il est urgent de diffuser ces connaissances auprès de tous et de proposer des solutions. Auprès des citoyens consommateurs là-bas et ici, et des citoyens producteurs et utilisateurs de la forêt, qui vivent à proximité des grands singes, de façon à ce qu’on comprenne pourquoi les lois existent et les avantages qu’il y a à les respecter. Pourquoi protéger une nature qui pour eux est ordinaire et non « extraordinaire » comme elle l’est pour nous (les chimpanzés ou les éléphants ont une place particulière dans notre imaginaire, ce n’est pas toujours le cas pour les populations locales et les populations autochtones qui les côtoient dans des interactions souvent négatives, pour protéger leurs récoltes, et associées à la peur). Développer des méthodes en essayant de réconcilier droit de l’environnement et droit de l’animal, est une des pistes, mais il est aussi surement indispensable de ne pas éluder la question économique.
On a mis en évidence, lors d’une motion présentée et votée au congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille en septembre 2021, que mettre en place des solutions, des stratégies, qui s’appuient sur des actions locales avec les peuples autochtones n’est pas anodin. Aujourd’hui, c’est plus d’un milliard de personnes qui dépendent des services écosystémiques de la forêt tropicale. Il faut essayer de mettre en réseau ces acteurs locaux à un niveau généralement plus large, et après au niveau international. Ce sont des actions qui sont en cours avec l’UICN et l’Unesco. Mais il faut aussi s’appuyer sur le choix d’un nouveau modèle économique, politique, et social.
À travers quelques images, je vais vous illustrer ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres d’ici, et vous montrer que, pour certains aspects, des solutions sont à portée de mains. Dans un grand parc national au cœur de l’Ouganda, on peut rencontrer des chimpanzés amputés d’un pied ou d’une main, voire des deux, victimes du braconnage. Sur la route qui traverse ce parc national, qui aujourd’hui est bitumé et fait plus de 20 mètres de large, on peut voir régulièrement des espèces menacées, telles que le colobe guéréza, des chats dorés ou des chimpanzés, écrasés sur cette route. On peut voir à la bordure de ce parc des chimpanzés consommant du maïs, puisque petit à petit la forêt tropicale a laissé place aux plantations de thé, de maïs, ou d’autres cultures vivrières qui attirent également les babouins et les éléphants. Mais également, parmi des chimpanzés, on peut en voir avec des malformations congénitales faciales, pour lesquelles les causes principales évoquées sont l’exposition des fœtus aux intrants chimiques de l’agriculture dans le ventre de leurs mères, lorsqu’elles consomment des plantes cultivées ou qu’elles y sont exposées à la lisière du parc.
Ces chimpanzés avec des malformations ou avec des troubles de la reproduction nous alertent et nous ouvrent les yeux sur nos choix : un modèle économique qui est basé sur une exploitation intensive avec des coupes rases, à seulement 15 mètres de la forêt tropicale, qui nécessitent d’arroser, d’utiliser des intrants chimiques de façon abondante, ou bien celui qu’offre l’agroforesterie, qui mêlent par exemple dans une même parcelle café, tournesol, ricin, bananiers et plantes aromatiques. On a le choix entre des champs de thé à perte de vue, pulvérisés de glyphosate, avec soi-disant des rendements importants, ou un modèle de production bio, durable, avec une biodiversité cultivée, comme c’est le cas à Kahangi Estate, une exploitation à deux kilomètres de la forêt de Kibale, avec une production artisanale de thé bio où des arbres créent de l’ombrage. Ce type de production permet donc aussi de générer des meilleurs revenus pour ces employés travaillant dans la filière thé. Ils auront ainsi moins besoin de chercher des ressources dans la forêt, c’est-à-dire de pratiquer des activités illégales en forêt et de braconner, puisque ces meilleurs revenus leur permettront d’aller acheter du poulet au village.
L’objectif est d’avoir une faune emblématique de ces forêts tropicales qui soit préservée, mais surtout qui soit plus utile, valorisable et souhaitable vivante que morte. Aujourd’hui, pour les Ougandais qui vivent à côté du parc, les chimpanzés représentent des menaces. Ils font partie de la nature ordinaire, voire ils sont nuisibles puisqu’ils viennent manger et détruire leurs cultures. Mettre en place des produits d’agriculture biologique durable, de commerce équitable, qui valorisent la préservation de l’habitat avec un label « Wildlife friendly » permet d’informer les consommateurs sur les engagements des producteurs et de générer des meilleurs revenus avec moins d’intermédiaires – puisqu’on parlait d’une question de coût économique tout à l’heure. Un thé produit localement de façon durable, dont les feuilles séchées vont directement du producteur au consommateur sans passer, comme c’est le cas aujourd’hui, par une société qui transforment les feuilles fraiches, puis les transportent jusqu’aux enchères à Mombasa où, après achats et emballage par des grandes sociétés, arrive enfin dans nos magasins. C’est une des solutions qu’on entrevoit et qu’on essaye de mettre en place en soutenant une initiative d’une cinquantaine de petits producteurs de thé à la lisière du territoire des chimpanzés de Sebitoli que nous étudions.
Améliorer le fonctionnement de ces écosystèmes, les revenus, réduire la pollution agricole, et simultanément, faire en sorte de préserver et de réconcilier la faune avec les humains qui vivent à côté, sont les défis que nous souhaitons relever aujourd’hui. Nos travaux de recherche viseront à évaluer l’efficacité de ce modèle pour la préservation des chimpanzés bien sûr, mais également de la biodiversité forestière.
Antoine Frérot[3]
Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aborder la responsabilité, le rôle, les actions des entreprises sur le thème qui nous réunit aujourd’hui. Au préalable, je voudrai bien sûr préciser que Veolia travaille avec des villes ou avec des industriels, et donc que ses activités n’ont pas de rapport direct, et même vaguement indirect, avec la faune sauvage. En revanche, toutes les activités de l’entreprise que je dirige, directement ou indirectement, ont souvent à voir avec la protection de la biodiversité. C’est à travers l’exemple de Veolia que je vais essayer d’expliquer les types d’actions que les entreprises peuvent imaginer. Puis, au-delà même des métiers de Veolia, ce que les entreprises pourraient imaginer de faire pour limiter leurs impacts négatifs sur cette biodiversité.
Les principales causes de dégradation de la biodiversité, elles sont bien connues : fragmentation et destruction des habitats naturels, pollution, surexploitation des terres et des mers, changement climatique, etc. Sur beaucoup de ces causes, les entreprises peuvent agir. Au moins sur deux d’entre-elles, et ce sont deux métiers principaux de Veolia : lutter contre les pollutions, corriger cette pollution, et également chercher des solutions alternatives à la surexploitation des ressources naturelles. Pas seulement les raretés, mais également les surexploitations. Ce sont deux métiers que Veolia exerce depuis longtemps et je vais commencer par la lutte contre les pollutions.
Les pollutions, ça a commencé, pour nous, par la pollution de l’eau. Ça s’est poursuivi par l’eau très sale, les déchets toxiques, puis les déchets banals… Et puis de fil en aiguille, l’ensemble des types de pollution, y compris désormais ce nouveau polluant depuis un certain nombre de décennies qu’on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Il existe des solutions pour traiter bon nombre de ces pollutions. Ces solutions sont efficaces. Pour prendre un exemple, je vais parler des eaux usées : qu’elles soient rejetées par les ménages, donc par les villes ou les communautés humaines, ou bien par les industriels.
Quand j’étais jeune, à la fin des années 1970, a eu lieu la première enquête du nombre de types de poissons que l’on pouvait trouver dans la Seine en période d’étiage[4] en plein été. Vous le savez peut-être, en plein été, le syndicat d’assainissement de la région parisienne est souvent le premier affluent de la Seine. Il se trouve qu’à l’époque, en 1978, on avait identifié trois sortes de poissons dans la Seine. Depuis, chaque année, le fameux syndicat d’assainissement de la région parisienne réitère l’étude. À la dernière campagne en 2019, ont été identifiées plus de 30 sortes de poisson et notamment, vous le savez certainement, le fameux saumon est enfin revenu. Comme quoi, on peut agir sur la pollution.
Lorsque le mur de Berlin s’est effondré et que nous avons été appelés à regarder ce que l’on pouvait faire dans ces pays derrière le rideau de fer, on a constaté qu’à Prague et à Budapest ou sur le Danube, la situation était la même que celle qu’on pouvait trouver dans les années 1970 dans la Seine. Et il n’y avait pas beaucoup plus de sortes de poisson d’ailleurs, à l’époque, dans ces rivières. Depuis, progressivement, chaque année, ça s’améliore. Dans la lutte contre les pollutions, des solutions existent, et lorsqu’elles sont mises en œuvre, bien sûr à large échelle, la biodiversité s’améliore. Bien évidemment sur la gestion ou le traitement des déchets toxiques ou l’élimination de ces déchets, c’est encore plus important.
Mais au-delà des pollutions, il y a également le problème de la surexploitation des ressources naturelles. De ce point de vue-là, les métiers de mon entreprise permettent aussi de proposer un certain nombre de solutions par la mise en œuvre, l’invention de ressources alternatives, à travers ce qu’on appelle l’économie circulaire. L’idée est de donner une deuxième vie à ces matières premières déjà utilisées, transformées en déchets, et qui peuvent devenir des ressources. Tout d’abord, cette économie circulaire permet clairement d’économiser des ressources naturelles. C’est le cas des ressources minérales, c’est le cas également de l’eau, puisque l’eau usée est un déchet, et que la première manière de faire face à la rareté de l’eau lorsqu’elle surgie, dans le monde, c’est de la réutiliser plusieurs fois elle aussi. D’ailleurs, en la réutilisant, on est obligé de la collecter et de la traiter, ce qui permet de faire d’une pierre deux coups et d’éviter la pollution tout en la réutilisant. C’est certainement de très loin la meilleure voie pour éviter les problèmes de rareté de l’eau. Ça permet également, à travers cette voie, d’éviter d’en extraire davantage de la nature, et notamment de protéger les zones humides. Ça permet aussi d’imaginer des formes d’agriculture, d’aquaculture propres, dès lors que bientôt il n’y aura plus assez de poissons dans la mer pour nourrir les hommes. L’aquaculture se développe énormément à travers le monde, et la seule manière de le faire de manière durable et soutenable, c’est de réutiliser l’eau des fermes aquacoles en les épurant pour éviter d’en prélever trop dans la nature.
Bien évidemment, d’autres voies d’économie circulaire permettent largement de protéger cette nature, et donc de protéger la biodiversité. Ça protège également en même temps de la pollution. J’ai évoqué l’eau usée : lorsqu’on la réutilise, on est obligé de la dépolluer. Je rappelle que la réutilisation des déchets pour les transformer en ressources limite considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Fabriquer une bouteille d’eau en plastique avec du plastique recyclé, c’est 70 % de moins d’émissions de gaz à effet de serre que lorsqu’on la fabrique par le procédé classique à partir de la pétrochimie. Cette économie d’émission est encore plus importante pour la réalisation de tous les métaux, puisque l’extraction, la transformation, le transport de ces matériaux, la fabrication des produits que nous consommons, consomment énormément, et émettent énormément de gaz à effet de serre. Lorsqu’on réutilise, et qu’on shunte donc des cycles de préparation de ces matières premières, on économise autant d’émissions. Et un recyclage de papier, de verre, de carton, mais aussi de plastique ou de métaux désormais, permettrait de diviser par trois les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie.
Il y a également d’autres types de déchets qui peuvent contribuer davantage encore à la protection de la biodiversité. Je pense notamment aux déchets organiques. On sait maintenant très bien proposer des fertilisants organiques qui viennent se substituer en totalité aux engrais chimiques. L’union européenne est en train de réfléchir à imposer un certain nombre de réglementations pour forcer l’usage de ces fertilisants organiques, mais aujourd’hui peu de déchets organiques sont véritablement utilisés pour fabriquer des engrais biologiques. Beaucoup sont utilisés en valorisation énergétique, ce qui est mieux que rien. Soit en biogaz, soit en chaleur. Mais un recyclage plus noble consisterait à transformer en produit, d’abord un fertilisant organique, et demain très certainement aussi par les process de bioconversion, en protéines, et en protéines animales notamment, afin de nourrir le bétail ou bien les fermes aquacoles, les poissons. Afin de réserver les céréales pour pouvoir nourrir des milliards de personnes sur cette terre dans quelques décennies, avec moins d’eau, moins d’énergie, et moins de sol. Tous ces métiers, ceux qui visent à traiter la pollution, et ceux qui visent à imaginer des ressources alternatives par rapport à l’extraction de matières premières de la nature, contribuent largement à la protection de la biodiversité de manière indirecte, ou parfois même presque de manière directe.
Par ailleurs, notre entreprise, comme toutes les autres, utilise beaucoup d’espace, puisque nos installations industrielles, nos usines de traitement, nos centres d’enfouissement, nos périmètres de protection de nos champs captant pour produire de l’eau potable, utilisent beaucoup d’espace. Et ces espaces, ils peuvent être gérés eux aussi de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus écologique pour protéger la biodiversité. Les zones zéro phyto, les aménagements propices à la restauration de la diversité comme les herbes hautes, le nichoir à oiseaux, les hôtels à insectes, peuvent être multipliés sur toutes les installations industrielles. Et on le sait bien, le fait de ne plus faucher et de laisser les herbes hautes permet beaucoup de choses qui étaient interrompues au préalable. Sur toutes leurs implantations spatiales, les entreprises peuvent jouer un rôle. Elles peuvent aussi jouer un rôle en essayant de limiter et de réduire leur empreinte spatiale. La concentration sur de plus petits espaces, le fait éventuellement de le faire en hauteur, permettrait aussi de ménager l’imperméabilisation des sols et l’utilisation de sol, pour là aussi permettre la conservation de la biodiversité. Bref, il existe des voies pour que l’industrie travaille plus proprement et plus durablement.
La clientèle de Veolia aujourd’hui, c’est la moitié de villes et la moitié d’industriels. Les solutions que nous proposons s’adressent autant aux communautés urbaines denses que sont les villes, qu’elles peuvent s’adresser aux industriels. Aujourd’hui, ce qui manque encore, c’est le fait de pousser, ou les villes, ou les industriels, à chercher à travailler plus proprement. Cela fait un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ce métier, et c’est vrai que je n’ai jamais vu, en trente ans, un pollueur décider spontanément de payer pour sa pollution s’il n’y est pas contraint. C’est pour ça qu’on a aussi, dans ce pays, inventé le principe du pollueur-payeur, qui s’est d’ailleurs répandu à l’ensemble de l’Union européenne pour le domaine de l’eau. Le principe pollueur-payeur, c’est la manière radicale d’éliminer la pollution. Dès lors que polluer coûte plus cher que dépolluer ou ne pas polluer, vous pouvez être surs que les acteurs s’alignent très rapidement sur l’idée de ne pas polluer, tant pour les anciens polluants dans les eaux, que les nouveaux avec les émissions de carbone. Il me paraît clair que la seule manière d’accélérer et d’aligner le jeu des acteurs, c’est de faire en sorte que polluer leur coûte plus cher que dépolluer. Nous verrons à ce moment-là rapidement les solutions d’abord se multiplier, puis se mettre en œuvre de manière générale. Je vous remercie.
Humberto Delgado Rosa[5]
Merci beaucoup pour l’invitation de la fondation, qui me permet d’être ici à la Sorbonne sur ce sujet qui est au centre de mon activité professionnelle, à la Commission européenne. J’avoue qu’une bonne partie de mon temps est dédiée au loup, et j’ai beaucoup aimé écouter le débat à son sujet.
La politique européenne sur la biodiversité a changé radicalement avec le Pacte vert. C’est la stratégie des orientations de la Commission européenne actuelle. Ce n’est pas seulement une stratégie climatique ou environnementale, c’est aussi une stratégie économique, un pari dont l’avantage est d’être plus avancé par l’innovation et le potentiel à adresser la crise écologique. C’est encore une stratégie sociale avec une idée de transition juste, qui emmène tout le monde dans la transition, en ne laissant pas de parties perdantes derrière elle.
Mais quelle est la nouveauté ? La nouveauté, ce n’est pas vraiment le renforcement de la politique climatique. À la Commission européenne, le climat était déjà une priorité avant le Pacte vert. La vraie nouveauté, c’est que le reste de l’environnement est porté au même niveau d’importance que le climat, incluant la biodiversité. D’ailleurs, dans ses orientations politiques, la présidente de la Commission disait déjà que l’Union devrait porter la biodiversité comme elle l’a fait pour le climat avec l’Accord de Paris par exemple.
Dire qu’il y a une crise écologique globale, la science nous le montre depuis longtemps. Nous connaissons le nombre d’espèces qui risquent l’extinction en court terme – environ un million ! -, mais aussi un chiffre qui impacte fortement : 96 % de la biomasse des mammifères terrestres est composée d’humains et de leur bétail. Le reste ne représente que 4 %. Ces résultats montrent que nous sommes vraiment allés très loin dans notre impact sur la nature. Mais pourquoi la politique bouge-t-elle ? C’est vous, c’est nous, c’est l’opinion publique. Et aujourd’hui, il y a une coïncidence entre la situation globale de la crise écologique, et la perception que de nombreux citoyens ont de cette crise globale. Bien sûr, parmi les signaux que la nature nous envoie, beaucoup sont évidents : les extrêmes climatiques, les feux forestiers, les inondations, etc. Au sein de ces signaux, certains sont indirectement liés à la biodiversité, ce qui n’empêche pas de s’en soucier. Si le plastique n’est pas du vivant, il a un impact dans le monde marin que tout le monde déteste voir, comme lorsqu’une baleine s’échoue sur la plage l’estomac rempli de sacs plastiques, ou qu’une tortue se retrouve coincé dans du plastique. Il y a aussi ce signal due à la perte d’insectes pollinisateurs, qui se fait remarquer en beaucoup d’endroits du monde et en Europe. Sans oublier bien sûr les feux de forêt. Je vous avoue que lorsque j’ai vu ces images de koalas brûlant lors des feux en Australie, je me suis dit : « Ça va provoquer des émotions, et les émotions font bouger la politique. » Parce qu’on ne peut pas compter uniquement sur les politiques engagés pour venir défendre la cause s’ils n’ont aucune base d’opinion publique pour soutenir ces avancées. Je crois également aujourd’hui qu’à travers la jeunesse qui assure ce mouvement pour le climat, on remarque, dans leurs attentes, l’arrivée de nouveaux sujets de préoccupation comme la nature, le style de vie, l’alimentation, etc. Il y a quelque chose qui a changé et qui a permis que l’on en arrive au Pacte vert.
Pour en revenir à la biodiversité, je crois sincèrement que la stratégie européenne à l’horizon 2030 est la plus ambitieuse que le monde n’ait jamais vu. Cette stratégie, en plus de vingt pages qui valent la peine d’être lues, va très loin pour essayer de dresser la liste de toutes les causes directes de perte de biodiversité. Cette liste, par ordre d’importance, va des changements d’usage de la terre et de la mer, à l’exploitation excessive, le changement climatique lui-même, la pollution, toutes sortes d’espèces exotiques envahissantes… Toutes ces causes arrivent dans un contexte où nous devons trouver un nouvel accord global pour la biodiversité. Ce n’est pas seulement de la COP 26 du climat que nous devons espérer des changements. C’est aussi de la COP 15 sur la conservation de la biodiversité, qui se tiendra en Chine en 2022, que devra aboutir un abordage différent. Cette fois-ci, ce dont nous aurons besoin, c’est davantage de mesures, quantifiables et vérifiables, pour la biodiversité. Et la science nous aide aujourd’hui à l’évaluer et la quantifier davantage.
L’Europe a souhaité mener le monde vers une stratégie européenne qui inclut de nombreux objectifs quantifiables pour la nature. Cette stratégie comprend des volets principaux: pour commencer, avec le mot-clé « protection », l’objectif est d’arriver à la protection et la gestion efficace de 30 % de terres et de mers de l’Union européenne. Un tiers de ces 30 % devra comprendre des protections strictes des écosystèmes, où la nature a besoin de s’autogérer, comme par exemple la protection des forêts primaires ou anciennes qui restent en Europe, avec des corridors écologiques qui puissent aider la faune sauvage. Vient ensuite l’amélioration de l’état de conservation d’au moins 30 % des espèces et des habitats protégés, qui incluent le loup. D’ailleurs, ayant écouté Jean-Marc, je peux avouer que la coexistence est bien la seule option compatible avec le cadre légal de l’Union européenne pour le loup et pour les autres grands prédateurs.
Un autre mot clé est la « restauration de la nature ». D’ailleurs, en ce moment, mes collègues et moi nous sommes très occupés à faire aboutir cette loi de restauration de la nature, qu’on devrait pouvoir présenter au commencement de l’année prochaine. Elle aura des objectifs légalement contraignants pour que les États membres puissent respecter cette obligation de restauration des écosystèmes dégradés en y incluant ceux qui sont les plus importants pour la mitigation et adaptation au changement climatique. D’autres volets de restauration couverts dans la stratégie concernent : la réduction de moitié de l’usage des pesticides jusqu’à 2030 ; l’obtention d’au moins 25 % des superficies agricoles de l’Union européenne converties en agriculture biologique d’ici 2030, au moins 10 % d’éléments de paysages importants pour la diversité en zones agricoles, etc.
En somme, vous trouverez dans la stratégie européenne des mesures pour toutes les pressions majeures. Pour la pêche, on travaille sur un plan d’action pour aider à la conservation des ressources. Il y a aussi des mesures pour éviter la capture accidentelle d’animaux marins protégés, comme les cétacés. Une « stratégie forêt » vient de sortir en juillet et fait davantage pour le climat, la biodiversité et la bio économie de la forêt. Cette semaine, on viendra annoncer la « stratégie sol », accompagnée d’une future législation pour la santé des sols qui manque encore à l’appel. Seront également présentes, des mesures pour les fleuves libres de barrières, pour la nature urbaine, pour les entreprises, la finance durable, la recherche, la coopération internationale. Bref, je crois que c’est une stratégie très complète qui mérite d’être lue.
Mes mots finaux serviront à expliquer pourquoi l’Union européenne fait tout cela. C’est parce que ça nous correspond. On a un intérêt dans ce pari à aller dans cette direction de durabilité. C’est important pour la faune, pour la nature, bien sûr, mais c’est surtout important pour nous, les humains. Nous avons besoin des services fournis par les écosystèmes que nous ne saurons jamais remplacer. J’ajouterai un mot aussi pour la France. Je crois honnêtement que la France est probablement l’État membre où le mot biodiversité, même avant le Pacte vert, compte le plus politiquement. C’est un mot qui est traité avec une attention que personnellement je trouve plus importante que dans d’autres États membres. Vous avez une ambitieuse loi restauration de la nature par exemple. La France aura une position très importante avec la présidence française du Conseil européen, en même temps que sera négocié ce nouvel accord global pour la biodiversité. C’est pourquoi nos attentes sur le rôle de la France, et de vous tous en tant que citoyens, seront très grandes. Merci.
Louis Schweitzer
Merci. Avant de donner la parole aux personnes de la salle, je voudrais poser une question à chacun des intervenants avec une réponse en moins de 30 secondes. Êtes-vous optimistes, et pensez-vous que nous arriverons à arrêter la 6e extinction de masse ?
Humberto Delgado Rosa
Disons que je suis né optimiste. Mais maintenant que je deviens plus vieux, peut-être un peu moins. De toute façon, on n’a pas d’autres alternatives. Je dis souvent à mes amis environnementalistes : « Ne craignez rien, vous allez gagner ! » Parce qu’on n’a pas d’autre planète. Mais bien sûr, quand on gagne une bataille, on regarde combien il y a de morts de notre côté. C’est là que mon optimisme n’est pas serein. On a déjà beaucoup dégradé la nature depuis que je suis né en 1960. J’ai appris dans le film de David Attenborough A life on our planet, que la moitié de la nature qu’il y avait dans le monde en 1960 avait disparu. Et ça réduit mon optimisme.
Antoine Frérot
Moi, je suis optimiste dans le fait que les activités humaines, et notamment les activités économiques, peuvent toutes se faire de manière propres et durables. Chaque fois qu’un problème se pose, si on y pense vraiment, on trouve une solution. La question, c’est d’imposer que les activités soient propres. Et là, c’est le rôle du politique. La technique et l’économie sauront les mettre en œuvre correctement et rendre les deux compatibles.
Maud Lelièvre
Moi, je suis optimiste parce que j’ai vu, pour la préparation du congrès de l’UICN, mais aussi à la COP à Glasgow, une jeunesse extrêmement compétente, extrêmement volontaire, extrêmement mobilisée, et je pense que c’est une clé de la solution. Je vais me permettre de lancer un appel parce qu’on a créé au sein de l’UICN une commission qui réunit aujourd’hui climat et biodiversité, pour laquelle on va chercher de jeunes experts dans le monde entier. Si vous avez envie de participer, de sauver concrètement la biodiversité, rejoignez-nous. Il n’y a pas de critère si ce n’est l’envie.
Sabrina Krief
Moi, je dirais qu’il y a plus de journées où je suis optimiste que découragée, mais il y a quand même un certain nombre de journées qui sont dures. Ce qui me rend optimiste, c’est de voir les gens en action sur le terrain. Effectivement, il y a un bel élan, je trouve, qui est né et qui essaime dans tous les coins de la planète. Donc oui, je dirais que je suis statistiquement optimiste.
[1] Présidente du comité français de l’UICN et membre du conseil international de l’UICN. Retour
[2] Vétérinaire et primatologue. Retour
[3] PDG de Veolia. Retour
[4] Période durant laquelle le débit d’un cours d’eau est particulièrement faible. Retour
[5] Directeur pour le Capital Naturel à la Direction Générale Environnement de la Commission européenne. Retour
Lire les autres interventions :
- Introduction par Louis Schweitzer
- Le respect de la faune sauvage : un impératif pour la biodiversité, un enjeu pour l’humanité par Gilles Boeuf
- Table ronde : Comprendre les menaces avec Laurence Parisot, Hélène Soubelet et Jean-Marc Landry
- Le rôle des associations et de l’opinion dans la protection de la faune par Allain Bougrain-Dubourg
- Message de la ministre de la Transition écologique et solidaire (vidéo), Barbara Pompili
- L’engagement pour préserver les animaux sauvages en liberté (vidéo), Nicolas Hulot et Louis Schweitzer
- Faune sauvage, de l’espèce à l’individu : un besoin de cohérence juridique par Muriel Falaise
- Table ronde : Sanctionner la maltraitance et la cruauté contre les animaux sauvages en liberté avec Loïc Obled, Marie-Bénédicte Desvallon et Manon Delattre
- Discussion avec Hugo Clément, journaliste engagé