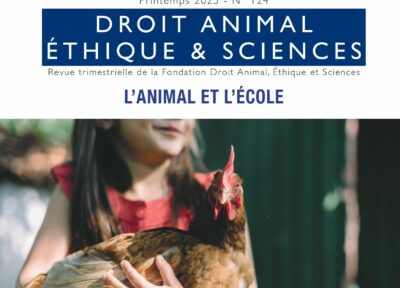La saison tauromachique va s’achever. Cette année encore, environ 70 corridas auront été organisées en France, et quelque 420 taureaux sacrifiés lors de ces sinistres « spectacles » de cruauté absolue. Une cruauté « active » exercée par les professionnels, du matador au poseur de banderilles et au picador, de l’organisateur au patron des arènes, une cruauté « passive » dont sont coupables les spectateurs complices, l’une comme l’autre en totale impunité.

L’article 521-1 du code pénal punit (assez sévèrement en principe, plutôt indulgemment dans les faits) l’auteur de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. Mais il précise que ces « dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Cette restriction a été introduite dans le code par l’article 1 de la loi n° 63-1142 du 19 novembre 1963, en même temps que le même article introduisait le délit d’acte de cruauté. Elle avait été obtenue sous la pression des élus des départements concernés, soucieux de ne pas contrarier leur réélection. La preuve en est donnée par l’article 3 de la même loi de 1963, qui indique : « Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux départements d’outremer », départements où sévissent les combats de coqs, très populaires, très suivis, et occasions de paris considérables, mais dont il s’agissait de ne pas priver les électeurs qui constituent le public, en dépit de la cruauté évidente de ces distractions…

Sitôt édicté l’article, la dérogation a soulevé une indignation qui n’a pas cessé, réanimée par les nombreuses campagnes d’opposition à la corrida, dont celles qu’a lancées notre Fondation, alors Ligue française des droits de l’animal, avec les diffusions européennes de son tract « Découvrez la corrida ». Le point le plus choquant, dans cette dérogation, est qu’il crée une inégalité des citoyens devant la loi, passibles ici d’amendes voire d’emprisonnement, et là blanchis et innocentés, alors d’auteurs de mêmes délits.
Le 21 juin 2012, le Conseil d’État a été saisi par l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC), sur la question de la conformité de l’article 521-1 aux droits et libertés garantis par l’article 1 de la Constitution de la France qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens ». Le 21 septembre le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 521-1 du code pénal est conforme à la Constitution, quant à la dérogation aux peines d’amende et de prison prévues pour les actes de cruauté et les sévices graves, si ces actes et sévices sont infligés lors des « courses de taureaux, lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».
Ce jugement a mis fin sans recours possible à la procédure dite « question prioritaire de constitutionnalité » initiée et déposée par le CRAC, lequel contestait la constitutionnalité de cette disposition dérogatoire. Compte tenu des intrications politiques, électoralistes, économiques, un jugement favorable était apparu, d’emblée, comme très improbable. Diverses personnalités politiques n’avaient pas manqué de prendre fermement position en faveur de la corrida, dont le ministre de l’Intérieur d’alors (Manuel Vals) avait déclaré qu’elle est « une culture qu’il faut préserver ». La question s’était posée, à la LFDA, d’un soutien à apporter à la procédure. Après étude, nous l’avons jugée téméraire, pour ne pas dire dangereuse. En effet, la question juridique posée au Conseil était celle d’une inégalité des citoyens devant la loi. C’était conduire le Conseil à faire le choix entre trois décisions :
- ou bien annuler la dérogation (ce que demandait l’organisation CRAC),
- ou bien maintenir le statu quo,
- ou bien encore, et c’était là que résidait un danger majeur, inciter à étendre la dérogation à tout le territoire national.
Cette troisième solution n’était pas à écarter, car alors le Conseil effaçait toute contestation sur la conformité avec l’article 1 de la constitution. À cet égard, si l’arrêt du Conseil est insupportablement couard et servile, il a été quand même un moindre mal en évitant le pire… Ceux qui savent comment fonctionne le Conseil constitutionnel font remarquer qu’il n’est pas exceptionnel que ses décisions soient préconçues, et que les arguments adéquats soient choisis dans un second temps, arguments qui figureront ensuite comme justifiant l’arrêt rendu…
En relisant aujourd’hui l’argumentation du Conseil et les considérants sur lesquels il a dit s’appuyer pour justifier son arrêt, on est littéralement stupéfié. On lit, par exemple, que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur […] déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que […] la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Ou encore : « En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que [cela ne puisse pas] conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti.» Stupéfiant, mais intéressant : par exemple, le Conseil d’État a donc estimé que le fait qu’elles soient traditionnelles justifie que des pratiques reconnues cruelles se perpétuent, au prétexte qu’elles ne concernent pas l’exercice d’un droit garanti ! Ou encore, on lit que la notion de tradition locale ininterrompue ne revêt pas de caractère équivoque et est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ! Un comble, alors que justement, nombre de combats ont été engagés en contestation de la signification de « locale » et de « ininterrompue » !
En ayant usé d’arguments contestables pour laisser les choses en l’état, le Conseil a rendu un arrêt qui laisse depuis un sentiment de gêne profonde, en référence aux décisions fondatrices de la République. En effet, l’exception territoriale contenue dans l’article 521-1 du code pénal non seulement crée une inégalité des citoyens devant la loi, mais en outre établit concrètement des avantages aux territoires concernés et à leur population, lesquels se trouvent ainsi posséder des privilèges. Or l’Assemblée nationale, le 11 août 1789, a voté un Décret relatif à l’abolition des privilèges, dont l’article 10 déclare :
« Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers de provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, soient abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français. »
Article 10 du Décret relatif à l'abolition des privilèges, 11 août 1789
A donc été aboli tout privilège, notamment accordé aux « provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants », et cela par un texte fondateur qui, pour autant qu’on le sache, n’a été abrogé à aucun moment depuis. À proprement parler, la dérogation est un privilège : elle est donc contraire aux fondements initiaux de la république française et donc contraire à ses principes actuels, puis que les fondements initiaux restent valables !
Mais qu’est-ce qu’un privilège ? Selon Littré, c’est un « avantage accordé à un seul ou plusieurs, et dont on jouit à l’exclusion de tous les autres, contre le droit commun ». De nos jours, c’est un avantage social ou financier (acquis sociaux, régime de retraite, garantie de l’emploi, taux de prêt, tarifs préférentiels, exonérations diverses, etc.) possédé par telle ou telle catégorie de citoyens, et qui ne bénéficie ni du consentement unanime de la population, ni d’un contrat de droit privé. Du point de vue de ses adversaires, le privilège est une disposition inégalitaire et antidémocratique. Il est évident que les privilèges et la discrimination devant la loi n’ont pas disparu avec la démocratie, malgré qu’ils soient destructeurs du droit naturel des personnes.
La dérogation concernant l’application des peines portées par l’article 521-1 du code pénal constitue-t-elle, en droit pénal, un « privilège » ? Partant du fait qu’une infraction est composée de trois éléments : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral, il est observé qu’un « fait justificatif » peut créer la suppression, par la loi elle-même, de l’élément légal de l’infraction, et en conséquence annihiler ses conséquences pénales. C’est le cas, par exemple, de la légitime défense. C’est également le cas de la corrida (et des combats de coqs), pour laquelle la loi exclut l’application de la loi en ce qui concerne l’existence même de l’infraction et donc les peines encourues pour sévices ou mauvais traitements. C’est la non-application du texte de loi général par l’effet d’un texte spécial, qui écarte l’infraction. Ainsi, on ne peut pas exactement parler, en droit, de « privilège » accordé à certains territoires, mais de « fait justificatif » (1).
À dire vrai, ces explications ressemblent beaucoup à des contorsions, permettant de sortir d’une position moralement indéfendable. Car la corrida reste la circonstance où un animal est victime de sévices graves, infligés en public, sans que ni les auteurs de ces actes ni leurs complices puissent être punis des peines prévues par le code pénal, au prétexte que ces sévices sont une coutume là où ils sont exercés. C’est là une faute éthique gravissime, une salissure morale qui ne fait pas honneur à notre pays. Dans la conférence que le recteur Robert Mallet avait donnée à l’Institut de France le 15 octobre 1985, lors du colloque « Droit de l’animal et pensée contemporaine », il avait prononcé cette phrase forte :
« Que l’ancienneté d’une erreur, que sa persistance, au lieu de provoquer sa condamnation et sa fin, justifient son maintien, que la cruauté, parce qu’elle est traditionnelle, soit pérennisée, voilà le scandale et voilà nos raisons de parler et d’agir au nom de l’intelligence et du cœur. »
Robert Mallet, le 15 octobre 1985
On remarquera, pour conclure, que le recours au Conseil d’État et le jugement final de 2012 ne faisaient référence qu’à l’article 521-1 du code pénal, et que l’article R. 654-1 du code n’a pas été considéré. Pourtant, il comporte exactement la même exemption d’application des peines applicables aux auteurs de « mauvais traitements » lors des corridas au motif d’une « tradition locale ininterrompue ». Il serait peut-être intéressant de répéter la procédure au sujet de cet article, ne serait-ce que pour provoquer et moquer le Conseil ?
- Les réflexions juridiques du paragraphe ci-dessus sur la nature du « privilège » nous ont été fournies par Jean-Marie Coulon, premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris, ex-administrateur de la LFDA.
Post-scriptum :
Privilège ou pas, stricto sensu, la corrida reste un « avantage » accordé à certains. Il en est d’autres exemples, tel l’exercice de la chasse. Les récentes rencontres entre le président Macron et la Fédération nationale des chasseurs, pilotées par le lobbyiste Thierry Coste, en sont une nouvelle démonstration. Elles sont dans la ligne des rencontres, également à l’Élysée avec le président Hollande (voir l’article « Le Chasseur français à l’Élysée », Revue n° 89 d’avril 2016) ou au ministère de l’Environnement (voir l’article « Faire la cour à la chasse », Revue n ° 93 d’avril 2017). Elles sont aussi dans la ligne des lois votées en faveur de la chasse dans les années passées, dont la scandaleuse disposition de 2008, qui a créé le délit d’opposition à l’exercice de la chasse, punie d’une amende de 1 500 euros, au même tarif que celle infligée pour mise à mort volontaire et sans nécessité d’un animal domestique. Sauver des vies animales est puni au même titre qu’infliger la mort !
Article publié dans le numéro 99 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.