Compte rendu de lecture
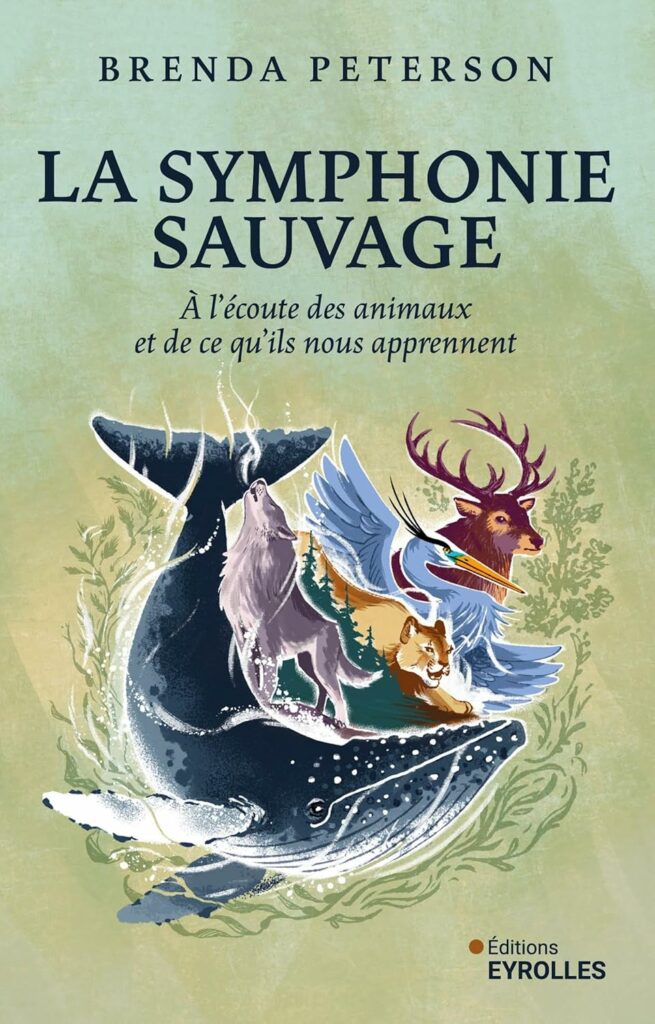
« J’ai été élevée comme un animal sauvage » (p. 11). C’est sur ce constat d’imprégnation précoce à l’animalité que commence le livre. L’autrice, fille d’un garde forestier, a passé ses premières années dans une cabane en Californie où, rappelle-t-elle, « nous étions entourés de bien plus d’animaux que d’humains » (p. 11). « Une partie de moi n‘a jamais quitté cette première forêt ni ces animaux sauvages qui ont été mes compagnons et mes mentors » (p. 12). Comme on sait que tout individu se forme durant la petite enfance, toute la suite de cet imposant ouvrage réside déjà, en filigrane, dans cette première constatation. « Les animaux ont été mes dieux, mes professeurs et mes alliés » (p. 43).
Comme le mentionne le sous-titre, l’ouvrage vise à montrer, sur un mode particulièrement romancé, incluant même parfois des contes populaires, comment des comportements animaux pourraient améliorer notre propre comportement et notre propre vécu, car « l’exploration des mondes sensoriels extraordinaires, de la culture et des stratégies de survie d’autres animaux nous révèle d’autres manières d’appréhender notre monde » (p. 17). Dans un univers sémiotique étendu, les animaux et même les arbres parlent « chuchotant à travers les peupliers trembles et les épicéas bleus » (p. 31). La vie au milieu des animaux apporte son lot d’expériences inoubliables. Les mêmes remarques et la formation que peuvent apporter les animaux aux humains s’applique aussi au cas très original des enfants sauvages, élevés par des animaux et auxquels l’autrice consacre de longs passages.
Brenda Peterson a beaucoup étudié les cétacés. Elle nous fait participer à la vie de ces animaux sociaux et très intelligents, à la résilience des baleines, à la rencontre avec une jeune baleine blanche ou béluga dont nous assistons en direct à la mise bas, à l’apparition inattendue et presque magique d’une baleine dans un endroit où elle était menacée d’extinction… Quant à aller au-delà, « déchiffrer le code et […] apprendre le langage d’autres espèces » (p. 101), l’autrice souligne les progrès qui ont été faits dans la compréhension de la communication chez les orques et le rôle social essentiel occupé par des matriarches : « nous avons tous besoin de grand-mères » (p. 230). Quant aux phoques, l’autrice raconte comment ont pu se développer des rapports exemplaires d’amitié et d’altruisme entre deux jeunes phoques.
Mais la communication avec les animaux concerne aussi des animaux terrestres. Brenda Peterson nous entraîne à l’écoute de l’émouvante « musique des loups » (p. 113) et des communications qu’elle porte. Elle rappelle aussi comment la comparaison avec les mœurs des canidés pourrait nous permettre de mieux comprendre « les premiers groupes d’hominidés » (p. 128). « Le lien évolutif entre le loup et l’homme est manifeste » (p. 243). L’attention portée aux cougars nous incite à considérer, avec davantage d’attention, « notre habitat commun » (p. 265). Et pour nous adapter aux animaux qui nous entourent, nous devrions sans doute prendre exemple sur la faune urbaine des ratons laveurs (p. 293) qui, eux, ont parfaitement su s’adapter à nous. Dans un autre groupe, l’analyse du chant des oiseaux révèle combien il est très riche en communication. Le chant des oiseaux a « également démontré qu’il améliore la santé mentale en calmant les tensions nerveuses » (p. 156).
Au-delà des préoccupations purement scientifiques, le livre est aussi remarquable par le talent de conteuse de l’autrice, capable, au-delà des connaissances, de nous faire partager des émotions purement artistiques de contact avec la nature : « les scientifiques recherchent des preuves observables et quantifiables, alors que les artistes, eux, s’intéressent à leur culture animale » (p. 115). La communication animale relève « des scientifiques, mais aussi des artistes » (p. 120). Notamment les ours « continuent d’alimenter notre imaginaire » (p. 366). Et il nous faut apprendre à « chanter avec les animaux » (p. 131). En outre l’appel à l’émotion artistique offre un autre apport de l’animalité, l’affection. « Les animaux nous apprennent à survivre à la perte […] même lorsque nous avons le cœur brisé » (p. 143). L’exemple animal peut être racine de l’empathie. C’est un chien qui a appris à l’autrice que « je peux aimer quelqu’un, même s’il s’intéresse très peu à moi » (p. 257).
Cet essai, j’allais dire, même s’il renvoie à la science, « ce conte poétique », qui nous plonge profondément dans la magie de la nature, ne peut manquer de faire appel à « l’éducation des prochaines générations » (p. 127). « Les premières histoires que nous racontons à nos enfants enseignent l’empathie et une attention particulière aux autres animaux » (p. 284). L’animal est, en général, maïeutique de l’affection et de l’amour. En même temps, « à l’heure où le changement climatique change tout pour tout le monde » (p. 326), nous pourrions améliorer notre vie en retrouvant une part de notre animalité et une harmonie perdue avec la « symphonie sauvage ». Retrouver, par un meilleur contact avec l’animalité, nos aptitudes à aimer et à vivre en harmonie avec un environnement changeant, sont sans doute les leçons qu’il faut retenir de cet émouvant plaidoyer. « Pourquoi ne pas apprendre les uns des autres à survivre et évoluer, et à chérir notre habitat, notre unique demeure ? » (p. 378).
Georges Chapouthier



