La question de notre responsabilité envers les animaux ne peut pas être pensée uniquement en termes de compassion ou de morale individuelle. Depuis une trentaine d’années, des philosophes et juristes travaillent à redéfinir les catégories politiques et juridiques qui structurent nos relations avec eux. C’est particulièrement le cas de Sue Donaldson et Will Kymlicka, auteurs de Zoopolis (2011), qui proposent une approche fondée sur l’inclusion des animaux dans la sphère de la justice. Leur réflexion distingue plusieurs statuts : les animaux « citoyens », les « résidents », les « souverains » et, en amont, les droits universels qui s’appliquent à tous les êtres sensibles.
Des droits universels et relationnels
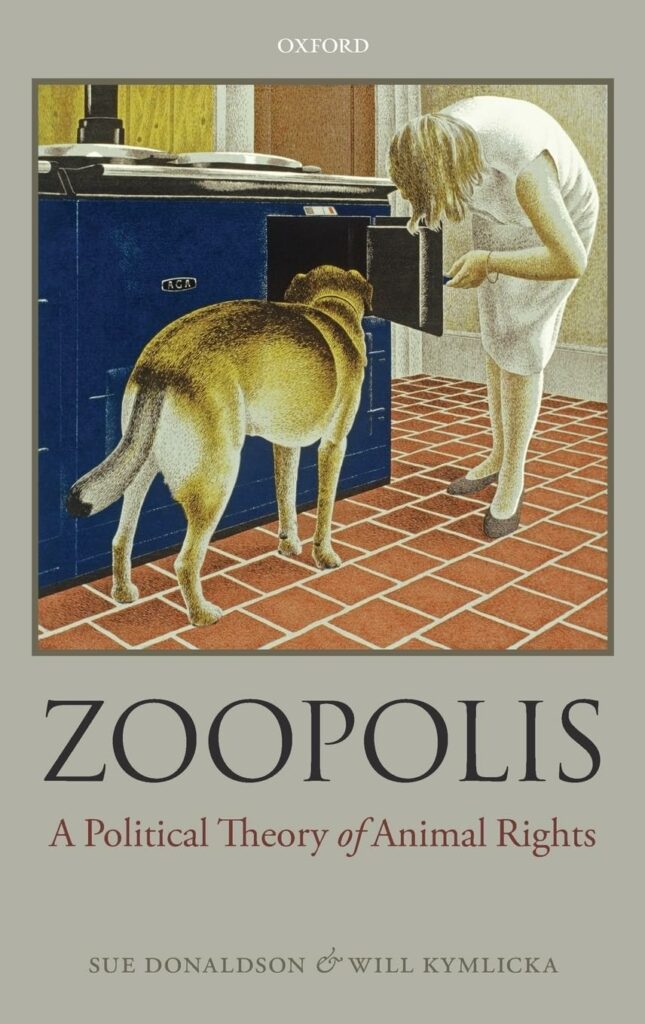
La première distinction repose sur l’idée que certains droits doivent être universels, c’est-à-dire accordés à tout animal sentient, indépendamment de sa relation avec les humains. Le droit à ne pas souffrir inutilement, à ne pas être soumis à la cruauté, ou à vivre dans un environnement qui permette la satisfaction de ses besoins fondamentaux en fait partie. Ces droits minimaux rappellent que, quelle que soit la catégorie à laquelle on rattache un animal, une protection de base doit s’appliquer. Citons l’article 2 de la Déclaration des droits de l’animal, rédigée par la LFDA : « Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité. »
À côté de ces droits universels, Donaldson et Kymlicka mettent en avant les droits relationnels, qui dépendent du type de lien entre l’humain et l’animal. Un chat vivant dans un foyer ou une vache dans un élevage ne peuvent pas avoir les mêmes attentes ni les mêmes garanties qu’un ours brun évoluant dans une réserve. C’est ici qu’apparaissent les trois statuts spécifiques.
Les animaux citoyens
Les animaux domestiques, qui vivent parmi nous depuis des siècles voire des millénaires, doivent selon cette approche être considérés comme de véritables « citoyens ». Cela ne signifie pas qu’ils participent à la vie politique de la même manière que les humains, mais qu’ils sont intégrés à notre communauté et que nous avons envers eux des devoirs comparables à ceux que nous avons entre citoyens humains. Concrètement, cela implique de leur garantir la sécurité, la santé, et surtout la possibilité de mener une vie épanouie dans un cadre familial ou collectif.
La reconnaissance des « chats libres » en droit français illustre cette tendance. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a transformé le regard porté sur le chat errant en lui conférant le statut de « chat libre ». Ce cadre légal impose désormais aux maires de stériliser, d’identifier puis de remettre ces animaux sur leur territoire d’origine. Depuis un arrêté du 3 avril 2014, les communes doivent en outre justifier toute mise en fourrière ou tout refus d’engager un programme de stérilisation. Le chat libre bénéficie ainsi de la reconnaissance juridique accordée aux animaux domestiques en tant qu’êtres sensibles. Néanmoins, il conserve une identité singulière, à mi-chemin entre le monde sauvage et celui des animaux apprivoisés, entre vie libre et proximité avec l’humain. L’article L211-27 du code rural les reconnaît comme appartenant au « patrimoine commun », et certaines villes développent des politiques de stérilisation et de protection. La LFDA a ainsi consacré à cette réalité un article intitulé « Le chat libre, un citoyen presque comme les autres » (revue n° 101), soulignant que ces animaux relèvent d’une responsabilité collective dépassant la simple tolérance.
Les animaux résidents
Les animaux liminaires, qui vivent à proximité des humains sans être domestiqués, constituent une catégorie de « résidents ». Pigeons, renards urbains, rats, sangliers en périphérie des villes… Ces animaux partagent notre territoire sans avoir été « invités ». La tentation est grande de les qualifier de « nuisibles », mais Donaldson et Kymlicka proposent une autre approche : les considérer comme des habitants légitimes de la cité.
Cela suppose de développer des politiques de cohabitation et de gestion non létale. Ainsi, plutôt que d’éliminer les pigeons par des campagnes de capture, plusieurs municipalités mettent en place des pigeonniers contraceptifs pour enrayer l’expansion du nombre de ces oiseaux. De même, la Belgique a réfléchi à limiter les pratiques sources de souffrance de la régulation du gibier. Ces démarches traduisent une évolution : reconnaître que la présence des animaux liminaires est un fait social durable, et qu’il revient à la collectivité d’aménager des règles de coexistence.
La sémioticienne Astrid Guillaume, membre de la LFDA, plaide pour la reconnaissance dans la langue française de cette notion de liminarité animalière :
« La liminarité animalière est le fait pour un animal de subir une modification de son comportement engendrée par le franchissement d’un seuil avec une autre espèce ou un autre individu. On observe une liminarité animalière chez les animaux domestiques et sauvages lorsqu’ils interagissent avec l’humain ou d’autres espèces, et que cette interaction a des conséquences sur leur être ou leur mode de fonctionnement à venir » (supplément de la revue n° 111).
Astrid Guillaume désigne la condition des animaux qui vivent « à la lisière » : ni domestiques, ni pleinement sauvages, mais en interaction constante avec nos sociétés. Elle souligne que leur invisibilisation dans la langue et les représentations traduit notre malaise à reconnaître leur place. Les prendre en compte oblige à dépasser la simple dichotomie « animal domestique/animal sauvage » et à penser les zones grises de notre responsabilité.
Les animaux souverains
La troisième catégorie concerne les animaux sauvages vivant dans des habitats préservés, plus ou moins indépendants de nos sociétés. Pour Donaldson et Kymlicka, ils doivent être considérés comme des « souverains » : des peuples non humains qui disposent d’une autonomie politique et territoriale. Notre responsabilité n’est pas de les intégrer à nos institutions, mais de respecter leur souveraineté, c’est-à-dire de ne pas envahir leurs territoires ni perturber leur organisation sociale.
Cela implique une révision profonde des pratiques actuelles de chasse et de gestion cynégétique. Protéger les animaux souverains suppose non seulement d’interdire les pratiques cruelles ou non sélectives, mais aussi de restaurer des habitats et de limiter notre emprise.
Vers une redéfinition des responsabilités
Au fond, la typologie proposée par Zoopolis et enrichie par la réflexion juridique francophone vise à nous responsabiliser selon la nature de nos liens avec les animaux. Nous ne pouvons pas exiger la même chose de nous-mêmes vis-à-vis d’un chien de compagnie, d’un pigeon des villes ou d’un grand cerf. Mais nous ne pouvons pas non plus prétendre que certains animaux n’ont aucun droit. Les droits universels fixent un socle, et les droits relationnels adaptent nos devoirs. Les animaux peuvent être membres, résidents ou voisins de notre communauté politique : reconnaître cette pluralité, c’est ouvrir la voie à une coexistence plus juste, où chaque individu trouve sa place.
Nicolas Bureau



