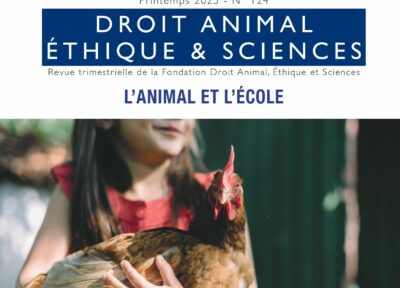Compte-rendu de lecture
La Grande Histoire de ce que nous devons aux animaux
Brian Fagan, traduit de l’anglais par Laurent Bury, Vuibert, Paris, 2015

Les livres qui relatent l’histoire de l’animalité, voire les débuts de la domestication ou de l’agriculture, sont déjà nombreux. Ce qui fait l’originalité du présent ouvrage, c’est le lien social fort qu’il propose entre l’homme et l’animal en montrant que les civilisations humaines ne se seraient sans doute pas développées sans le concours des animaux.
Brian Fagan est un archéologue britannique, professeur émérite d’anthropologie en Californie et très versé dans la vulgarisation. Son ouvrage est une grande fresque de l’histoire commune de l’humanité et de l’animalité, bourrée d’anecdotes et très agréable à lire. Ceci dit, il n’est pas nécessaire d’adhérer à tout ce que dit l’auteur. Ainsi quand il affirme (p. 9) : « Nous appartenons à l’espèce Homo sapiens, ces êtres sages qui se distinguent de toutes les autres créatures… », on peut penser qu’appliqué aux singes nus que sont les êtres humains, auteurs de tant de guerres, d’atrocités ou de pollutions, le terme « sages » n’est peut-être pas le plus opportun. Mais quand, un peu plus loin (p. 10), Fagan relate que « nos ancêtres les plus lointains étaient des prédateurs […], que des prédateurs » et qu’il suggère que seuls les Homo sapiens étaient « d’authentiques animaux sociaux, animés d’un vif désir de [se] lier non seulement entre [eux], mais aussi avec d’autres êtres vivants » (p. 10), on ne peut s’empêcher de trouver cette dichotomie trop schématique. Il faudrait davantage d’arguments pour reléguer les Homo présapiens au statut d’animaux non sociaux et pour faire de l’Homo sapiens cette merveille de socialité, différente de ses ancêtres. En de telles occasions le propos de l’auteur semble un peu rapide et superficiel.
Il reste que l’ensemble de l’ouvrage est une belle fresque. On y assiste aux débuts de la domestication du chien. « Comme les hommes, les loups sont des animaux sociaux qui vivent en meutes soudées » (p. 56) et « le processus par lequel les loups deviennent des chiens fut autant social que biologique » (p. 63), d’où finalement cette étonnante symbiose que constituent ces deux prédateurs devenus amis. Plus tard, c’est la révolution agricole qui, justement ne pouvait avoir lieu sans les animaux, puisque « les chasseurs se firent fermiers : ils ne se déplaçaient plus, mais restaient accrochés à leurs champs, à leurs troupeaux et à leurs pâturages » (p. 83). La révolution agricole voit la domestication de nombreux animaux : cochons ou ruminants variés, dont l’auteur tente de nous raconter l’histoire. Les domestications se font parfois plusieurs fois de suite. Ainsi, pour le taureau « la plupart des spécialistes pensent que le Bos primigenius [note : l’auroch] fut domestiqué au moins deux fois, peut-être trois » (p. 123). Mais « retracer les modifications subtiles qui transformèrent des bêtes sauvages en animaux domestiques est extrêmement ardu puisque nous ne disposons que de fragments d’os pour nous permettre de comprendre les pratiques d’élevage » (p. 95). L’élevage associe les populations humaines au mode de vie des animaux élevés. Celui-ci est dicté par « le passage des saisons et, dans les pays plus chauds, par la disponibilité en eau et en herbe » (p. 101). D’où, outre la sédentarisation liée à l’agriculture, des rythmes humains (fêtes, cérémonies…) souvent liés à l’élevage, qui a donc largement modifié les cultures humaines. La hiérarchie des richesses devint un attribut essentiel des sociétés humaines sédentarisées : « Les propriétaires détenaient des avoirs transmis de génération en génération et la taille de leur cheptel était un signe de richesse » (p. 109). « Bétail, pouvoir, richesse : l’étroite relation entre les bovins et leurs éleveurs apparut aux premiers jours de la domestication » (p. 127).
Si la domestication n’a pas été « une relation à sens unique, mais a relevé d’un phénomène général, inscrit dans un profond bouleversement entre l’homme et son environnement naturel » (p 132), l’auteur insiste sur trois animaux particuliers, qui lui semblent avoir particulièrement modifié les civilisations humaines :
- l’âne,
- le cheval,
- chameau.
« Les ânes travaillent aux côtés des hommes depuis 8 000 ans » (p. 155). Moyens de transport remarquables, véritables « camionnettes de l’antiquité » (p. 171), ils ont permis le développement des relations commerciales à l’intérieur même des empires, comme l’Égypte, puis entre tous les empires du Moyen-Orient. « Les caravanes d’ânes mirent en contact les cours et les villes bien avant que les grands pharaons n’aient de vues sur des territoires plus lointains » (p. 171). « Marchands, voyageurs, pèlerins, tout le monde se servait des ânes » (p. 180). Excepté peut-être le cheval, aucun animal n’eut « un aussi grand impact sur le cours de l’histoire que l’âne » (p. 185).
La domestication du cheval permit, en combinaison avec la roue, le développement d’autres types de transport comme les chariots, voire l’utilisation de chars de guerre chez les Hittites de l’ancienne Turquie. D’autre part, le cheval monté renouvelle, pour plusieurs siècles, l’art de la guerre. Avec l’apparition des cavaliers et des chevaliers, le cheval devient l’animal noble pas essence. « Contrairement à la population active, qui travaillait avec des chevaux pour gagner sa vie, la noblesse considérait l’équitation comme l’attribut d’un gentilhomme » (p. 272). L’auteur montre, d’autre part, comment toute l’histoire de la Chine, pauvre en chevaux, et de ses rapports avec les conquérants (cavaliers) mongols, qui culminent avec les empires de Gengis Khan et de Kubilaï Khan, repose sur l’utilisation du cheval. « L’empire mongol dépendait énormément des chevaux » (p. 238) et, dans la Chine de Kubilaï Khan, pour accroître leur efficacité, « les courriers à cheval portaient des clochettes signalant leur approche et la nécessité d’une nouvelle monture. Ces hommes pouvaient parcourir 400 kilomètres en une journée » (pp. 240-241). Enfin une place importante est aussi reconnue aux camélidés, chameau et dromadaire, véritables « vaisseaux du désert » (p. 245), sans lesquels les hommes n’auraient jamais pu vivre dans des environnements hostiles comme le Sahara, ni parcourir la route de soie. Et même si, de nos jours « le camion Diesel ; avec ses quatre roues motrices, est l’équivalent actuel du dromadaire saharien, il subsiste tout de même […] quelques traces de l’ancien commerce caravanier » (p. 262), comme le transport des plaques de sel au Mali.
La domestication animale, qui a fait des humains les maîtres absolus, s’est aussi traduite par de graves brutalités. Certes les paysans pouvaient souvent entretenir des rapports relativement paisibles avec leurs animaux, mais il reste que des comportements abominables se sont greffés sur la domestication, particulièrement dans l’Europe chrétienne. Même les chevaux, étaient souvent, devenus vieux, traités avec une grande cruauté : « En un instant, sur le caprice de son maître, une monture adorée devenait un amas de chair impersonnel, jeté en pâture à d’autres bêtes » (p. 275). Lors de fêtes, comme lors de la saint Luc « on fouettait les chiens et on noyait pour le plaisir les animaux errants » (p. 279). À la suite du pape Grégoire IX, qui avait décidé que le chat était une créature diabolique, « les chats étaient lapidés comme créatures démoniaques en collusion avec les hérétiques, cloués à des poteaux lors des fêtes de village, puis tués » (p. 279). Un roi de France avait même ordonné que « des sacs remplis de félins vivants soient brûlés en public » (p. 279). On pourrait multiplier les exemples. En outre « l’expansion des villes […] aggrava le sort des bêtes quelles qu’elles fussent (p. 283). Les animaux étaient partout, entassés dans les maisons et dans les cours » (p. 283). Petit à petit les animaux furent « dépersonnalisés par la croissance démographique » (p. 288) et l’appétence pour la viande. Avec les élevages intensifs, les animaux « devinrent des chiffres plutôt que des individus » (p. 288), dans un « enfer des bêtes » (p. 283) et « une lugubre réalité » (p. 297). Les chevaux furent aussi les victimes d’innombrables guerres et « de la folie militaire » (p. 299). À Waterloo, par exemple, on pouvait être « épouvanté par la misère des chevaux blessés ou agonisants. Certains luttaient, les entrailles visibles, et tentaient vainement de se lever » (p. 315).
Certes quelques animaux de compagnie dans les familles nanties, échappaient au triste sort qui frappait l’animalité en général dans les sociétés industrielles, et de timides efforts pour la protection animale virent le jour en Angleterre avec les débuts de la RSPCA à la fin du XIXe siècle. La fresque se clôt donc sur le constat d’une « bienveillance sélective » (p. 349) qui nous laisse « la responsabilité […] de prendre part au combat qui oppose morale et altruisme d’un côté, exploitation égoïste et impitoyable de l’autre » (p. 352). D’utiles notes complètent cet intéressant ouvrage.
Article publié dans le numéro 93 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.